Comme on aime en librairie aborder un livre en l’ouvrant à une page au hasard, je prends plaisir en ce moment à découvrir un auteur que je ne connaissais pas, Ramuz, par le roman qui ouvre le deuxième tome de ses œuvres en Pléiade : Présence de la mort (1922).
Je m’attendais à trouver un romancier de la terre, une sorte de Giono suisse, et je trouve d’abord un auteur de science-fiction d’une actualité brûlante. Voici quelques lignes de la première page :
Par un accident survenu dans le système de la gravitation, rapidement la terre retombe au soleil et tend à lui pour s’y refondre : c’est ce que le message annonce.
Toute vie va finir. Il y aura une chaleur croissante. Elle sera insupportable à tout ce qui vit. Il y aura une chaleur croissante et rapidement tout mourra. Et néanmoins rien encore ne se voit.
Rien ne se voit, personne n’y croit et on continue à vivre à peu près comme avant. Pour peu de temps, toutefois, car la température augmente d’un degré par jour.
Je lisais ces pages début juillet.
Mais là n’est pas le seul intérêt de ce livre où un poète narrateur, monté une dernière fois en imagination sur une grande barque noire, adresse en tirant son chapeau un salut aux gens, aux montagnes, au “Rhône-lac” :
Toi qui venais avec une cadence le jour et la nuit, m’instruisant de l’accent, m’instruisant des retours, m’instruisant des longueurs ; avec une cadence, la mesure de tes vagues : trois et trois, et puis trois et puis encore trois, c’est douze ; et puis un silence, et puis tout repart. (…) Et salut ! vite encore, parce que tu t’en vas, parce que tout s’en va, parce que rien ne doit durer, parce que rien ne peut durer, salut une dernière fois !
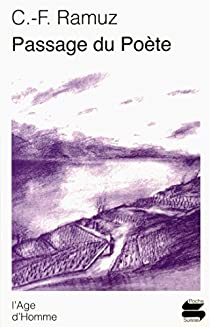 Rythme de l’eau et rythme des phrases fusionnent dans cette profération. Voir, sentir et vivre ne sont pas séparés d’écrire. Une parole s’affirme, et tout de suite surgit la figure énigmatique d’un vieux vannier portant une hotte blanche, dans lequel on devine un double du poète. Un autre roman écrit presque conjointement et que j’ai lu peu après celui-ci, Passage du poète, donne à ce vieux vannier une survie littéraire et un nom : Besson (mot signifiant “jumeau”). En tressant ses osiers sur la place ombreuse d’un village vaudois, ce passant fait monter la vie de ses habitants, humble magicien tissant comme l’auteur le visible et l’invisible.
Rythme de l’eau et rythme des phrases fusionnent dans cette profération. Voir, sentir et vivre ne sont pas séparés d’écrire. Une parole s’affirme, et tout de suite surgit la figure énigmatique d’un vieux vannier portant une hotte blanche, dans lequel on devine un double du poète. Un autre roman écrit presque conjointement et que j’ai lu peu après celui-ci, Passage du poète, donne à ce vieux vannier une survie littéraire et un nom : Besson (mot signifiant “jumeau”). En tressant ses osiers sur la place ombreuse d’un village vaudois, ce passant fait monter la vie de ses habitants, humble magicien tissant comme l’auteur le visible et l’invisible.
On dirait que Besson prend avec les yeux les choses qui sont et les arrange, de sorte qu’elles sont à nouveau, et elles sont les mêmes et sont autrement.
Et on dirait que sans l’avoir prévu, une lectrice néophyte est tombée sur deux oeuvres qui en disent beaucoup sur l’art poétique de Ramuz.
(À suivre)

