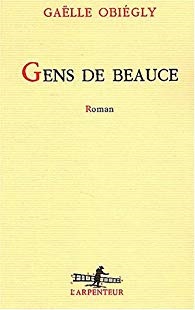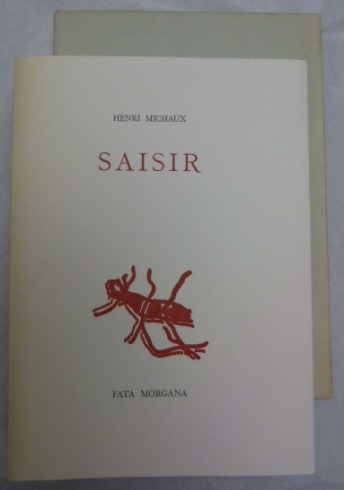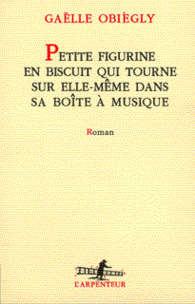 Je parlais l’autre jour, à propos de Gens de Beauce (ci-après, en déroulant le blog), de la mère muette à la place de qui on écrit. Ici, dans ce court roman au long titre, tout commence par un père que l’on renonce à visiter sur son lit de mort, et les premières pages empoignent le lecteur :
Je parlais l’autre jour, à propos de Gens de Beauce (ci-après, en déroulant le blog), de la mère muette à la place de qui on écrit. Ici, dans ce court roman au long titre, tout commence par un père que l’on renonce à visiter sur son lit de mort, et les premières pages empoignent le lecteur :
Le ciel était sombre, lézardé, à certains moments, par les échos acides du soleil. Je voyais passer et repasser devant moi mon père enfant, déguisé en petite fille, paradant à la fête de l’école. J’aurais voulu être sa maman.
Puis :
Mon père était un homme saoul. Il chantait toutes sortes de chansons tristes et d’amour, comme un idiot, il encerclait de ses bras des femmes au cou gracile, des enfants sauvages.
 Un père fantomatique resurgit à divers moments du roman :
Un père fantomatique resurgit à divers moments du roman :
Mon père en chemise pâle comme sa figure, pâle comme son regard avec ses manches pas boutonnées. Jamais fermées. Lâches, légères, flottantes, vives comme ses mouvements avant qu’il finisse fossile.
Se mêle ou se substitue à lui un certain Jack, sorte de figurine intérieure comme la plupart des personnages de Gaëlle Obiégly, qu’elle poursuit dans le train, dans la rue, à la piscine, pour l’enlacer ou le tuer, et qu’elle rejoint à la fin en lui avouant des « pensées d’assassin ». Mais Jack réagit avec indifférence, « ça ne lui fait ni chaud ni froid », et le roman se clôt ainsi :
Le funeste sort de mon père, il appelait ça une maladie. Les personnes ne croient qu’aux faits, aux causes, aux conséquences. Les désirs ne sont pas pris en considération.
C’est donc la littérature qui prend en considération les désirs de meurtre et d’amour fou, et ce premier roman ose aller droit au père et à l’obscur.
(Fin)