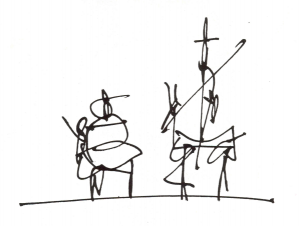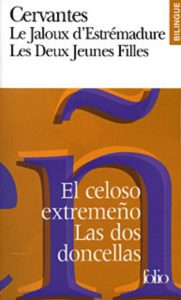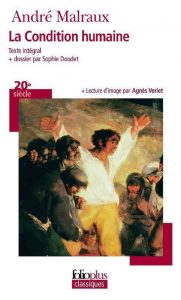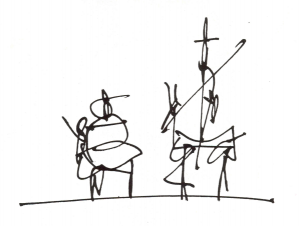
Don Quijote, illustration d’Antonio Saura
J’ai lu avec intérêt ces derniers temps divers livres sur le travail de traducteur ̶ auquel je me livre en ce moment avec mon amie Marina ̶ et lisant par ailleurs Don Quichotte, je suis tombée sur une comparaison qui me gratte encore l’esprit :
Don Quichotte, qui en dehors de son domaine de folie tient des propos parfaitement pertinents avec un esprit des plus pénétrants, visite à Barcelone la boutique d’un imprimeur-traducteur, et voici ce qu’il lui dit :
(…) Me parece que el traducir de una lengua en otra, como no sea de las reinas de las lenguas, griega y latina, es como quien mira los tapices flamencos por el revés, que aunque se veen las figuras son llenas de hilos que las escurecen, y no se veen con la lisura y tez de la haz (…)
Traduire d’une langue dans une autre, dès lors qu’il ne s’agit pas des deux langues reines, la grecque et la latine, c’est comme regarder au rebours les tapisseries de Flandres : bien que l’on en distingue les figures, elles sont pleines de fils qui les voilent et ne se voient point avec l’uni et la couleur de l’endroit.
(II, ch. 62, Traduction de Jean Canavaggio, folio p. 593.)

Un texte traduit est pour Don Quichotte l’envers filandreux de l’original. Et à vrai dire, dans mon entreprise actuelle de traduction, j’en suis exactement à un point de fabrication d’une texture rugueuse où fils et sacs de nœuds tiennent lieu de figures, comme si le texte résistait à sa traduction. Les mots sont là mais le texte ne respire pas.
En attendant de passer à la phase suivante, je prends pour moi la phrase d’encouragement qu’adresse Don Quichotte à son interlocuteur :
Y no por esto quiero inferir que no sea loable este ejercicio del traducir; porque en otras cosas peores se podría ocupar el hombre, y que menos provecho le trujesen.
Je ne veux pas en conclure que cet exercice n’est point louable, car le traducteur pourrait s’occuper de choses pires et qui lui soient moins profitables.