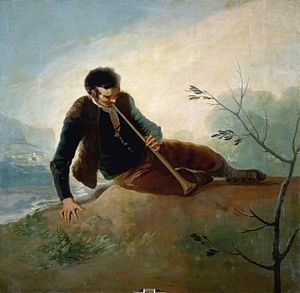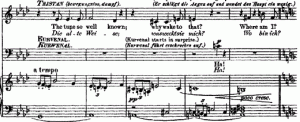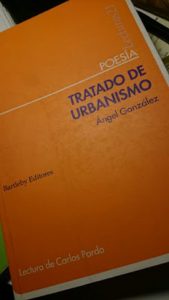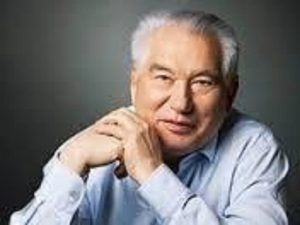
Tchinghiz Aïtmatov (1928-2008) est né dans un village du Kirghizistan comme le narrateur de son roman Djamilia, l’adolescent Seït, qui transporte en charrette des sacs de grains à la gare pour alimenter en 1943 l’armée soviétique. Seït travaille en compagnie de sa belle-sœur, la joyeuse Djamilia dont le mari est au front comme tous les hommes d’URSS.
Ce texte kirghize a été découvert en 1958 par Louis Aragon qui en a fait une préface  élogieuse intitulée “La plus belle histoire d’amour du monde”. Le roman, qui fait une centaine de pages, se déroule dans un village aux confins de la montagne kirghize et de la steppe kazahke, au bord d’une rivière au nom sonore, le Kourkouréou.
élogieuse intitulée “La plus belle histoire d’amour du monde”. Le roman, qui fait une centaine de pages, se déroule dans un village aux confins de la montagne kirghize et de la steppe kazahke, au bord d’une rivière au nom sonore, le Kourkouréou.
À Seït et Djamilia s’adjoint dans le transport des grains un soldat blessé à la jambe, Daniïar, orphelin né au village mais ayant grandi au Kazakhstan. C’est un homme maigre, taciturne, qui a tendance à dresser l’oreille « comme s’il avait perçu quelque chose qui ne parvenait pas aux autres », à s’isoler sur une butte dominant la steppe, à dormir dehors au bord du Kourkouréou. Les villageois le traitent comme un pauvre diable inoffensif et Djamilia se moque de lui. Elle aime chanter les chansonnettes du village en conduisant ses chevaux, et demande en plaisantant à Daniïar de chanter à son tour.
Et c’est là que va retentir la mélodie qui semblait vibrer en sourdine dans toutes les pages qui précédaient. La voix qui sort de Daiïnar n’est plus la voix de Daiïnar, son chant n’est plus un de ces airs de village que chantait Djamilia, mais quelque chose qui sort du fond de l’âme humaine, éveillant l’écho des rochers voisins, emplissant la nuit étoilée :
C’était une chanson des monts et des steppes, tantôt qui s’envolait sonore comme les monts kirghiz et tantôt s’étendait sans entrave comme la steppe kazakh,
une chanson qui unit amoureusement les terres et se mêle dans l’air aux autres sensations dont ce roman est riche : la senteur des pommes, les miels chauds du maïs en fleur comme un lait qu’on vient de traire, et le souffle tiède des fumiers séchés.

C’est un chant de vie, de peine et d’exil :
Et tout cet univers de terrestre beauté et d’angoisses, Daniïar l’ouvrait devant moi dans son chant. Où avait-il appris, de qui tenait-il tout cela ? Je comprenais que seul ainsi peut aimer sa terre, qui de longues années a langui d’elle, qui a souffert pour cet amour-là. Quand il chantait, c’était lui que je voyais, tout petit garçon, vagabondant par les chemins de la steppe. Peut-être était-ce alors que dans son âme avaient été engendrées ces chansons de la patrie ? Et peut-être était-ce quand il marchait par les verstes de feu de la guerre ?
C’est aussi un chant d’amour pour Djamilia :
car tout cet énorme amour de la terre natale qui avait en lui engendré cette musique inspirée, Daniïar lui en avait entièrement fait hommage, c’était pour elle qu’il chantait, il la chantait.
Djamilia acquiert par ce chant la dimension d’une femme-monde qui unit les paysages et les langues, et dont Daiïnar rêvait quand il combattait l’envahisseur nazi dans les tranchées, ce qui a certainement contribué à enthousiasmer l’auteur des Yeux d’Elsa.
Enfin, le chant de Daniïar modifie profondément le jeune Seït :
Lorsque je l’écoutais, j’avais envie de me jeter sur la terre et de l’étreindre à la façon d’un fils.
Et s’éveille à ce moment en lui une vocation de peintre, car :
Les chansons de Daniïar m’avaient mis l’âme à l’envers. Je marchais comme en songe et regardais le monde avec des yeux surpris, comme si je le voyais pour la première fois.
Djamilia est un livre qui parle avec délicatesse et une rare profondeur de la puissance d’un chant. Ce roman où règne une grande unité de lieu ̶ quelques kilomètres parcourus par une charrette à grains entre un village et la gare voisine ̶ nous ouvre par la voix du chanteur les grands espaces de l’Asie centrale. Ce n’est pas un chant qui tue comme celui des Sirènes, ce n’est pas le « Liebestod » de Tristan et Isolde, c’est un chant tellurique porteur d’amour et de vie.