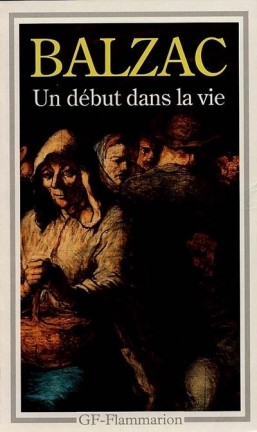 J’évoquais le 6 juillet sur ce blog l’agacement d’André Du Bouchet devant les jeux de mots et je me promettais, un peu chiffonnée, de relire une œuvre de Balzac où ils abondent : Un Début dans la vie. C’est chose faite. Le début du roman retrace un trajet en « coucou » (voiture publique) entre Paris et L’Isle-Adam au cours duquel des jeunes gens qui ne se connaissent pas font assaut de fanfaronnades et de plaisanteries. L’un d’eux, apprenti peintre surnommé Mistigris, s’amuse à déformer les expressions toutes faites ̶ jeu que pratiqueront près d’un siècle plus tard les surréalistes ̶ car « en ce moment, la mode d’estropier les proverbes régnait dans les ateliers de peinture. C’était un triomphe que de trouver un changement de quelques lettres ou d’un mot à peu près semblable qui laissait au proverbe un sens baroque ou cocasse ».
J’évoquais le 6 juillet sur ce blog l’agacement d’André Du Bouchet devant les jeux de mots et je me promettais, un peu chiffonnée, de relire une œuvre de Balzac où ils abondent : Un Début dans la vie. C’est chose faite. Le début du roman retrace un trajet en « coucou » (voiture publique) entre Paris et L’Isle-Adam au cours duquel des jeunes gens qui ne se connaissent pas font assaut de fanfaronnades et de plaisanteries. L’un d’eux, apprenti peintre surnommé Mistigris, s’amuse à déformer les expressions toutes faites ̶ jeu que pratiqueront près d’un siècle plus tard les surréalistes ̶ car « en ce moment, la mode d’estropier les proverbes régnait dans les ateliers de peinture. C’était un triomphe que de trouver un changement de quelques lettres ou d’un mot à peu près semblable qui laissait au proverbe un sens baroque ou cocasse ».
Mistigris nous en offre un vaste échantillon raccordé de manière plus ou moins tirée par les cheveux à la conversation qui se déroule dans la voiture :
Les petits poissons font les grandes rivières
On a vu des rois épousseter des bergères
Qui veut noyer son chien l’accuse de la nage
Le voilà comme un âne en plaine
On ne trousse jamais ce qu’on cherche
Etc.
 Bien sûr, à la différence des surréalistes, Balzac attribue ces jeux de mots à certains personnages et ses blagues de rapins sont mises très efficacement au service d’un projet réaliste, comme lorsque les pensionnaires du Père Goriot s’amusent à terminer les mots en -rama selon une mode des années 1830. Mais j’entends aussi ces calembours comme des éclats de rire dont le romancier parsème son roman, avec une jubilation gratuite comparable à celle qu’il doit éprouver quand il tord la langue pour transcrire l’accent alsacien du Baron de Nucingen : – Fûs nus brenez tonc bir tes follères (« Vous nous prenez donc pour des voleurs », Splendeurs et misères des courtisanes) ; ou lorsqu’il fait écrire une lettre d’adieu par la grisette Ida dans Ferragus : – Adieu, maman, je te lege tout ce que j’é (…) comme il a souffert ce povre cha » (« je te lègue tout ce que j’ai. Comme il a souffert ce pauvre chat »). Toute personne ayant, dans sa vie, corrigé des fautes d’orthographe sait que « povre cha » est aussi contraire à la vraisemblance dysorthographique que les deux démonstratifs « ce » parfaitement conformes aux lois de la grammaire.
Bien sûr, à la différence des surréalistes, Balzac attribue ces jeux de mots à certains personnages et ses blagues de rapins sont mises très efficacement au service d’un projet réaliste, comme lorsque les pensionnaires du Père Goriot s’amusent à terminer les mots en -rama selon une mode des années 1830. Mais j’entends aussi ces calembours comme des éclats de rire dont le romancier parsème son roman, avec une jubilation gratuite comparable à celle qu’il doit éprouver quand il tord la langue pour transcrire l’accent alsacien du Baron de Nucingen : – Fûs nus brenez tonc bir tes follères (« Vous nous prenez donc pour des voleurs », Splendeurs et misères des courtisanes) ; ou lorsqu’il fait écrire une lettre d’adieu par la grisette Ida dans Ferragus : – Adieu, maman, je te lege tout ce que j’é (…) comme il a souffert ce povre cha » (« je te lègue tout ce que j’ai. Comme il a souffert ce pauvre chat »). Toute personne ayant, dans sa vie, corrigé des fautes d’orthographe sait que « povre cha » est aussi contraire à la vraisemblance dysorthographique que les deux démonstratifs « ce » parfaitement conformes aux lois de la grammaire.
Cette manière de malaxer le langage comme une pâte ou un ballon gonflable sans se soucier de coller strictement au réel fait partie de ce qui plaît à ceux qui aiment Balzac, et les amène à sourire avec une qualité de tendresse que ne suscite aucun autre écrivain. Comme l’a remarqué Proust, « Les autres romanciers, on les aime en se soumettant à eux, on reçoit d’un Tolstoï la vérité comme de quelqu’un de plus grand et de plus pur que soi » (Sainte-Beuve et Balzac, p. 272). A l’inverse aimer Balzac n’intimide pas, malgré toute l’immensité de son génie, en partie grâce à cette absence de « pureté », à cette gaieté un peu brouillonne qui éclate partout dans l’œuvre.
« La fraîcheur, c’est le langage qui ne se referme pas sur soi », disait André Du Bouchet pour argumenter son dégoût des jeux de mots. Oui, mais c’est la joie bon enfant, l’absence totale de gourme, l’amour de la langue pour elle-même, en un mot la fraîcheur qui alimentent les jeux de mots de Balzac, petits poissons frétillant dans sa grande rivière.
