On voit en ce moment des auteurs qui publient ici et là le Journal de leur confinement, tout contents de se trouver une matière romanesque nouvelle. Cela m’a donné envie de lire des Journaux d’écrivains pendant la grippe dite “espagnole” (voir commentaire de Claude Ferrandiz) de 1918-1919, la fameuse dernière grande pandémie dont on nous parle ces derniers temps. Je voulais voir ce que ces écrivains en disaient. Mon attente a été déçue et je suis heureuse de cette déception, car elle me donne une nouvelle preuve que la vraie littérature ne dit jamais ce qu’on voudrait qu’elle dise.
Pour ce qui est de Gide c’est très simple : pas un mot sur le sujet en 1918 et 1919 (l’épidémie a sévi à peu près un an en France). Il y avait des événements autrement plus importants qu’une pandémie, me dira-t-on. Mais Gide ne parle pas non plus dans son Journal des dernières grandes batailles ni de l’armistice. Il vit avec sa femme et cousine Madeleine dans sa demeure de Cuverville, fait quelques échappées à Paris et un voyage en Angleterre avec son cher Marc Allégret. Son Journal est lacunaire et clairsemé, il le délaisse pendant des semaines, voire des mois. Eric Marty nous prévient dans son introduction que Gide n’est pas un mémorialiste qui réorganise sa vie et ses pensées. L’image qu’il donne de lui et du monde est dispersée et brisée, son but étant d’obtenir par l’écriture journalière une présence à soi qui est son bien le plus précieux. Peut-être aussi a-t-il été, en 1918, saisi certains jours par l’histoire du monde au point d’en oublier son Journal. Ce sont des choses que l’on comprend un peu aujourd’hui. Selon Eric Marty, il existait un autre Gide qui lisait avec passion les journaux, s’inquiétait des drames qui se nouaient au front, compatissait avec les combattants, donnait son temps à un centre d’accueil pour les réfugiés. Mais il se méfiait des grands discours qui aliènent la parole authentique. « Être présent à l’histoire ne signifie pas adhésion aveugle à l’actualité », dit Eric Marty.
Dans le Journal de 1918, je n’ai remarqué que deux ou trois opinions exprimées sur des faits d’actualité. Le 13 février, par exemple, il commence par regarder la campagne autour de lui :
L’air est tiède. Les bourgeons sont gonflés d’espoir. Les oiseaux exultent, et le rouge-gorge qui vient prendre de petits morceaux de viande au bord de ma fenêtre ne s’effarouche plus quand j’approche.
Et ce n’est qu’ensuite qu’il parle du rationnement alimentaire décrété trois jours avant et que tout le monde dans sa commune respecte scrupuleusement, alors que dans les communes voisines, « on se gausse » :
A chaque règlement nouveau qu’on impose à la France, chaque citoyen français s’inquiète de savoir non point comment le suivre, mais comment l’éluder. J’en reviens toujours à ceci : on parle de défaut d’organisation ; c’est défaut de conscience qu’il faut dire.

L’homme qui se gratte le front à côté de Marc Allégret est le poète irlandais William Butler Yeats, Photo datée de 1920, prise par Ottoline Morrell.
On voit surtout Gide requis par son œuvre. Il continue et parachève les « dialogues socratiques » de Corydon sur l’homosexualité qu’il veut avant la fin de l’année confier à l’impression, « si l’imprimeur n’était pas dérangé par les bombardements », dit-il en passant. Il commence autour du 17 février La Symphonie pastorale qu’il achève au mois d’octobre. Les premiers carnets des Faux Monnayeurs ralentiront le Journal de 1919, interrompu également à l’automne par « une grippe » dont il n’a pas le souci de préciser la nature. Pendant ces deux années sa passion pour Marc Allégret croît de jour en jour. Si le 10 mai 1918 il consacre une grande page à déplorer que les Français ne sachent pas inventer l’arme qui mettra fin au conflit, les notations du 11 mai tiennent en deux lignes : “Le plus grand bonheur, après que d’aimer, c’est de confesser son amour ». Et le 17 mai : “Ah ! c’est déjà le plein été. Mon cœur n’est plus qu’un immense hymne à la joie… » Son grand chagrin de l’année est que sa femme Madeleine, désespérée par son voyage à Londres avec Allégret, a détruit toutes ses lettres depuis trente ans (j’en aurais fait plus qu’autant) : « C’est le meilleur de moi qui disparaît”…
Désir de vivre, d’aimer, d’écrire : voilà ce que, loin des plaies et des fléaux de ce début de siècle-là, on trouve dans le Journal de Gide de 1918.
Le prochain billet sera consacré au Journal de Virginia Woolf, même année, que j’ai en ce moment sous ma patte de mouette. Si parmi mes lecteurs et amis quelqu’un veut parler d’un autre Journal de 1918, qu’il me l’envoie en doc word et je le publie avec joie sur ce blog.
N.B. du 31-03-20 : Patrick Abraham me signale que Marc Allégret fut touché par la grippe “espagnole” en novembre 1918, ce qui apparaît, non dans le Journal, mais dans la Correspondance de Gide avec le cinéaste. Le 12-11-18 : “Mon cher petit Marc, Je pense à toi tout le jour et tous les jours. je ne me console pas de te savoir malade. Hier, j’ai couru tout seul les boulevards : avec qui d’autre que toi aurais-je pu souhaiter d’être ?”


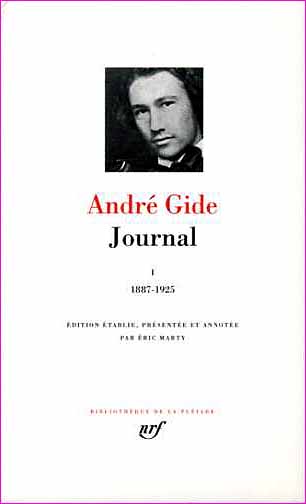

La pandémie grippale de 1918, dite « grippe espagnole », est une pandémie de grippe due à une souche (H1N1) particulièrement virulente et contagieuse qui s’est répandue de 1918 à 1919. Bien qu’étant d’abord apparue aux États-Unis, puis en France, elle prit le nom de « grippe espagnole » car l’Espagne – non impliquée dans la Première Guerre mondiale – fut le seul pays à publier librement les informations relatives à cette épidémie.
Je préfère donc l’utilisation grippe de 1918. Ou les guillemets.
Je savais ça, bien sûr, Claude, et croyais que mes lecteurs le savaient aussi. Mais vous avez raison, je vais modifier un peu mon billet pour que ce soit parfaitement clair. Merci !
Chère mouette qui, malgré les vents contraires, poursuit vaillamment sa proie,
j’aime beaucoup cette page qui nous montre que les hommes ne changent guère à un siècle de distance. La phrase d’Eric Marty : “Être présent à l’histoire ne signifie pas adhésion aveugle à l’actualité ” me semble très juste. Et, puisque je suis sensé tenir ce qui ressemble un Journal, j’essaie aussi de ne pas me laisser emporter par le vacarme actuel.
Le vieux Gide, narcissique en diable, me touche quand il écrit que : ” Le plus grand bonheur, après que d’aimer, c’est de confesser son amour “. Merci pour tout que tes lectures réveillent en moi! Très affectueusement . Protège-toi. Jacques
Merci de ton affection, grand frère. J’ai en effet pensé parfois à toi et à ton Journal de 2019 qui fait toujours mes délices sur Poezibao, et qui par hasard s’avère très adapté à ce que nous vivons depuis quelques semaines.
P.S. En fait, ce n’est pas “par hasard” que ton Journal est adapté à ce que nous vivons. Il contient une sorte de sagesse qui vaut autant pour hier que pour aujourd’hui. Et je recommande à tout le monde de lire “Dans la forêt des jours” de Jacques Robinet, le “feuilleton” dans la revue de poésie en ligne Poezibao. https://poezibao.typepad.com/
Ma “seconde mère”, Josefina Vicente (Pepica), née en 1917, me racontait comment cette épidémie avait touché sa ville, Elche, et sa famille.
Dans son Journal Littéraire, le lundi 11 novembre 1918, Paul Léautaud parle de la mort d’Apollinaire avant l’armistice signé le matin même. “J’ai été atterré. Je perds un ami que j’adorais comme homme et comme écrivain. Il était destiné à devenir quelqu’un. J’avais vu tout de suite en lui le vrai poète, extrêmement particulier, évocateur, avec La chanson du mal-Aimé, que je fis prendre au Mercure, sans la lecture habituelle, il y a quelques années.” “A noter ce détail à propos de la mort d’Apollinaire: L’armistice signé ce matin, et la nouvelle connue aussitôt à Paris, la joie populaire a commencé dans son plein. La rue de Rennes, la place Saint-Germain-des-Prés, le boulevard Saint-Germain remplis par la foule. Sur le boulevard Saint-Germain, sous les fenêtres mêmes de la petite chambre dans laquelle il reposait mort, sur son lit couvert de fleurs, des bandes passaient en criant: “Conspuez Guillaume! Conspuez Guillaume!”
Ce texte est absolument poignant (presque trop ? Quelque chose d’un peu “littéraire” ? En passant Leautaud se vante d’avoir fait entrer Apollinaire au Mercure). Oui, je pensais à Apollinaire que Gide, je crois, ne fréquentait pas.
Littéraire. C’est sûr.
“A chaque règlement nouveau qu’on impose à la France, chaque citoyen français s’inquiète de savoir non point comment le suivre, mais comment l’éluder. J’en reviens toujours à ceci : on parle de défaut d’organisation ; c’est défaut de conscience qu’il faut dire.” Rien de nouveau sous le soleil!
Très bonne idée, Nat, j’attends avec impatience des nouvelles de Virginia Woolf.
Elle est spéciale dans son Journal… Aiguë et futile à la fois. Une langue de vipère pas possible !
Ah, tu lui fais une très bonne pub!