Quand on parle du loup on en voit partout. Il en va de même pour les vers à soie :
L’Homme sans postérité est un récit de l’écrivain autrichien Adalbert Stifter (1805-1868). Son traducteur Georges-Arthur Goldschmidt le présente ainsi dans une postface éclairante et sensible :
A première vue, rien ne semble émerger de cette œuvre volontairement banale, parfois humble jusqu’à la trivialité, mais que soulève pourtant une émotion à laquelle il n’est pas facile de résister : cette sorte de tristesse ample et forte qui baigne ici toute réalité.
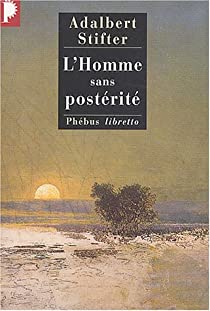
C’est un roman de formation réduit à une simple expression : pour préparer son départ dans le vaste monde, l’adolescent Victor retourne quelque temps dans la maison où vit sa mère adoptive avec sa fille Hannah. La dernière journée, au cours de laquelle il ne se passe “rien d’extraordinaire”, il fait ses adieux au ruisseau, aux hêtres, au grands rochers, puis rencontre dans le jardin Hannah qui récupère des étoffes de soie qu’elle a mises au soleil pour les faire sécher. Voici leur dialogue :
— C’est de la soie très fine.
— Très fine.
— Est-ce qu’il en existe de plus fines encore ?
— De bien plus fines que ça.
— Tu aimerais avoir beaucoup de belles robes de soie ?
— Non. Pour les fêtes, bien sûr, c’est magnifique, mais comme on n’a pas tellement besoin de vêtements de fête, je n’ai pas tellement envie de soie. Les autres robes sont belles aussi, et puis la soie, ça fait toujours un peu guindé.
On remarque la simplicité et la concision de cet échange qui laisse imaginer des sentiments que ces deux jeunes gens ignorent encore à la veille de leur séparation.
Victor enchaîne :
— Le ver à soie est une bien malheureuse créature, non ?
— Pourquoi ça, Victor ?
— Parce qu’il faut le tuer pour recueillir son fil.
— C’est ce qu’on fait ?
— Oui, on passe son cocon dans la vapeur bouillante où on l’enferme avec du soufre, et l’animal à l’intérieur meurt ; sinon il dévorerait les fils et en sortirait sous forme de papillon !
— Pauvre bête !
— Oui, et à notre époque, en plus, on le sépare de son pauvre pays natal, tu sais, Hanna, là où il pourrait bien ramper sur ses mûriers ensoleillés. Une fois chez nous, il est enfermé, et on le nourrit de feuilles qui pourtant poussent dehors, elles, et qui de toute façon ne valent pas celles de son pays…
Certes, le narrateur attribue à Victor des pensées mélancoliques pour les mettre en résonance avec la tristesse qui précède son départ. Mais bien au-delà, il fait preuve à travers son personnage d’une sympathie directe pour la condition du ver à soie, condamné à l’exil et à la mort pour le bénéfice des humains. Ceci me rappelle l’attention au vivant de Karl-Philipp Moritz, précurseur du romantisme allemand, occupé à ressentir “l’espèce d’existence” de chaque animal. Le ver à soie n’est pas une allégorie sans chair à l’usage des poètes mais un être à part entière dans le monde.
Par ailleurs, ces soieries que Victor aide Hannah à porter jusqu’à la maison sont aussi douces que le fil léger, précieux et solide qui les unit. Au moment de son départ, Victor reçoit des mains de Hannah un portefeuille “doublé de soie d’un blanc de neige”…
Ceci n’est qu’un exemple du creusement du réel qui donne sa mystérieuse profondeur à tous les éléments de l’univers d’Adalbert Stifter.

beau! Georges Arthur Goldschmidt a écrit un très beau livre sur la solitude de Rousseau, sur les Confessions et les Rêveries où il a découvert “un frère” qui l’a accompagné et lui a permis de survivre à la solitude et aux souffrances qu’il a connues en tant qu’enfant caché pendant la guerre. Je parle beaucoup de sa lecture de Rousseau à la fin de mon livre, une fois de plus on se croise 🙂