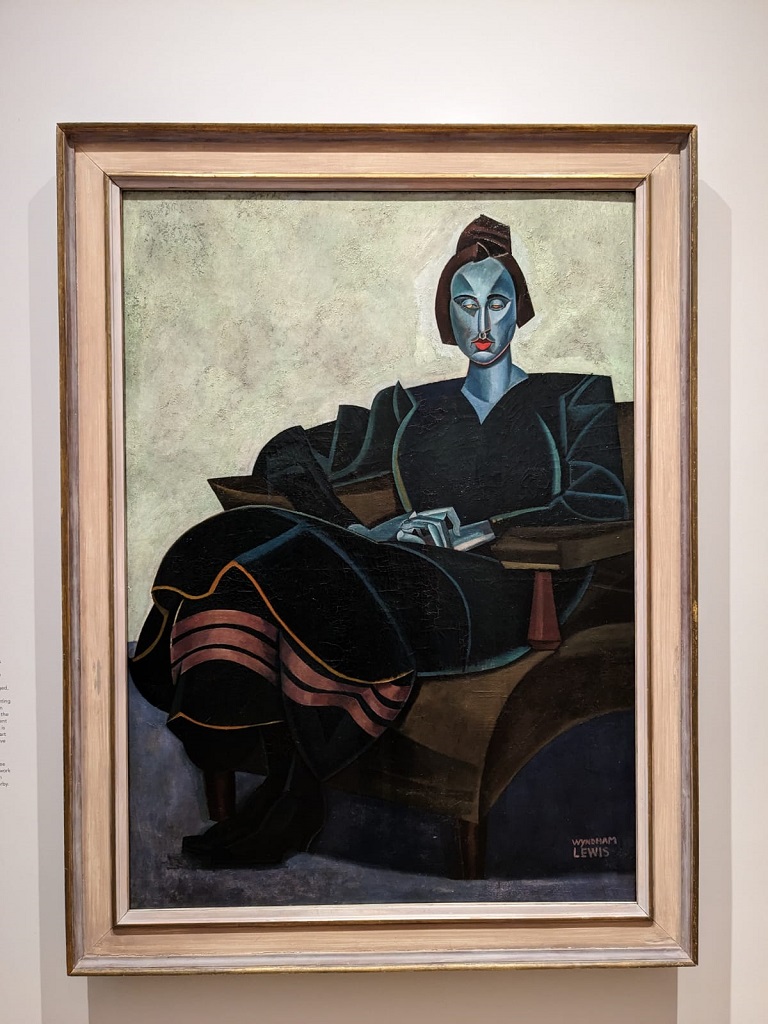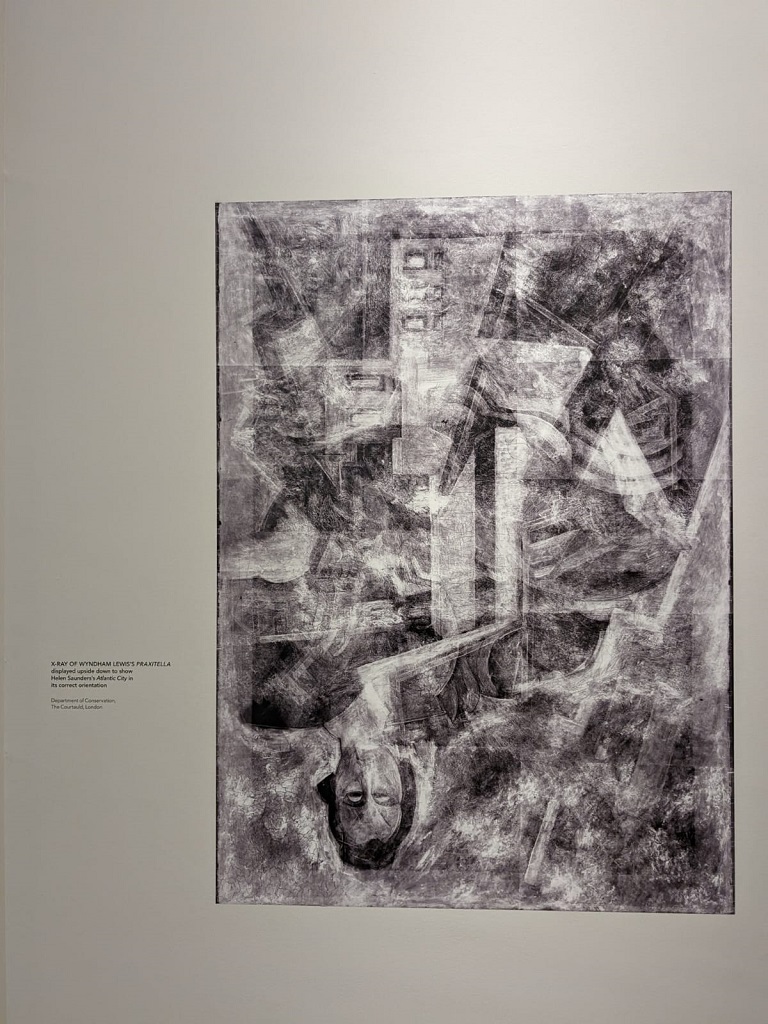Pendant
Des filandres de souvenirs
Comment s’appelait ? Qu’est devenu ? Il y a 15 ou 20 ans que ? (…)
Un filandre de pensée sérieuse
(
Une résolution morale
Gardons-nous de tout jugement généralisateur et définitif sur un pays, quelles que soient les visées impérialistes de ses dirigeants actuels. Henri Michaux a publié en 1933 sur le Japon des choses très dures et très injustes qu’il a regrettées ensuite.
Après
Recherche diurne sur Michaux
Un Barbare en Asie :
Le texte a été beaucoup remanié par l’auteur dans des rééditions successives, et voici une dernière préface à « Un Barbare au Japon » que Michaux a ajoutée quelques mois avant sa mort :
Je relis ce barbare-là avec gêne, avec stupéfaction par endroits. Un demi-siècle a passé et le portrait est méconnaissable.
De ces fâcheuses impressions d’un voyageur déçu, reste peut-être par-ci par-là une notation « historique » pour des lecteurs qui voudront retrouver quelque chose d’une de ces singulières périodes d’avant-guerre, que dans la suite on n’arrive plus à ressentir, à imaginer même, tant « l’air du temps », un air particulièrement chargé, leur a conféré de signification pesante, englobante et déviante.

“Mitsuhirato gun” (Tintin Wiki I Fandom). “Tintin et le lotus bleu” a été publié par Hergé en 1936.
Ce Japon d’aspect étriqué, méfiant et sur les dents est dépassé.
Il est clair à présent qu’à l’autre bout de la planète, l’Europe a trouvé un voisin.
Ses multiples recherches, l’actualité de ses œuvres, sa curiosité sans bornes en tant de domaines de science et d’art – et les plus nouveaux – où on s’entre-regarde, émules ou admirateurs, suscitent une étrange connivence qui augmente.
H.M. Mai 1984. (Oeuvres Complètes, 1, Pléiade, p. 387.)
Henri Michaux n’a pas fait disparaître la partie d’Un Barbare en Asie dont il avait honte. Il a fermement exprimé sa gêne et contextualisé l’ensemble. Gallimard a suivi.
C’est ce que ne font pas les éditeurs de Roald Dahl qui abusivement changent les mots d’un texte sur lequel l’auteur, dans sa tombe, ne peut plus rien.