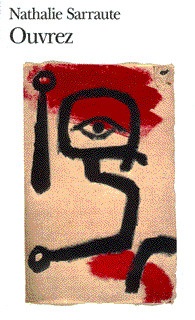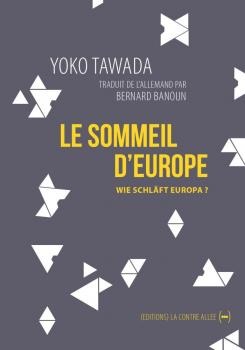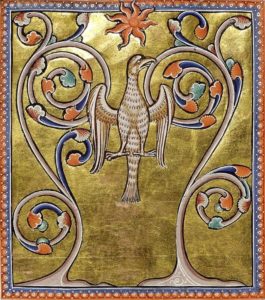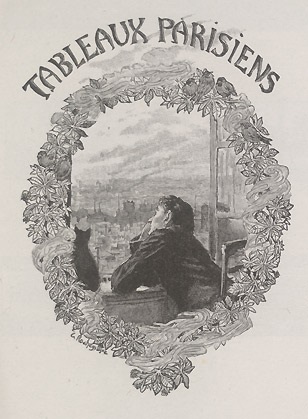Ricardo Urgoiti vu par José Luis Pastora (voir billet du 08-12)
Le 20 septembre 1979
Le 14, à Fontarrabie, est décédé Ricardo Urgoiti, illustre basque né à Zalla, qui laissera un grand vide parmi les ingénieurs, les intellectuels et les artistes. Après ses années de formation initiale où il cultive les langues, les sports et la musique (avec des dons extraordinairement précoces de pianiste et à l’occasion de compositeur), il devient ingénieur des Ponts et Chaussées. On voit déjà poindre à l’horizon un homme hors du commun. Son professeur d’électrotechnique l’envoie compléter sa formation aux États-Unis, à la General Electric où il parcourt et étudie à fond tous les secteurs de son domaine, des laboratoires de recherche au dernier des ateliers. Il s’intéresse à tout mais son imagination créatrice le tourne vers la radiodiffusion. Nous sommes dans les années 20 : né avec le siècle, il est ingénieur depuis 1921. Il revient en Espagne, travaille, lutte, et avec de très modestes moyens, devient le pionnier de la radio : il crée la Unión Radio, puis Filmófono (n.d.t : avec son ami Luis Buñuel), qui regroupait les salles de cinéma les plus importantes d’Espagne. Il invente également le « filmófono », appareil destiné à synchroniser les films muets.

De g. à d. Luis Buñuel et Ricardo Urgoiti lors de retrouvailles des deux vieux amis (je n’ai pas établi de manière sûre la date de cette photo).
En même temps, il n’abandonne jamais le sport et triomphe dans tous ceux qu’il pratique, gagnant trophée sur trophée. Il pilote de petits avions (à plus de 70 ans il passe le mur du son), prend continuellement des risques sur terre, sur neige, sur air et sur mer, toujours accompagné par la fortune.
Pendant la guerre civile espagnole, parenthèse de la patrie, il s’exile à Buenos Aires et fait des films en tant que scénariste, musicien, technicien, réalisateur, etc., en fonction des besoins. De retour en Espagne il retrouve un pays grelottant, brisé, mais qui veut vivre. Ricardo hésite, mais son père (n.d.t. un éditeur de grand renom) et Don José Ortega (n.d.t. le philosophe Ortega y Gasset) le poussent à s’intéresser à la biologie. Il écoute, réfléchit. L’heure est à la pénicilline. Il repart en Amérique et revient avec un trésor sous le bras : les antibiotiques. Il monte une société de laboratoires qui démarre avec de la pénicilline d’importation, et rapidement prend la tête des fabricants mondiaux d’antibiotiques (…) Ami du prix Nobel le professeur Chain (qui s’est éteint dernièrement), il s’acquiert, grâce à son autorité et à son talent d’homme d’affaires, l’estime et l’admiration de tous ses collaborateurs. Sa vaste culture lui permet d’être également un homme de plume qui diffuse avec un grand talent les créations scientifiques. Il nous laisse quelques articles d’astronomie à partir des débuts de l’ère spatiale, des écrits biographiques, littéraires et philosophiques. (…)
Sa vie a été la vie de son époque et c’est dans cette époque qu’elle s’y est pleinement réalisée. (…)
Sur la plage de Fontarrabie, au bord de cet océan dont il a enduré tant d’assauts, il est brusquement tombé. Son cœur avait lâché, l’eau baisait ses pieds.
Qu’il repose en paix.