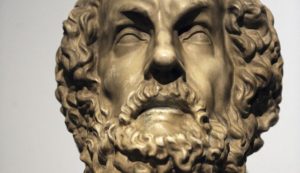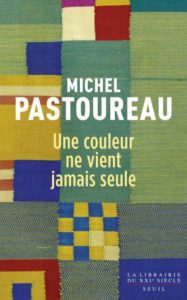Je suis un peu gênée en entendant le mot fragrance en français, à cause du redoublement de ses r qui tient du gargarisme et accentue laidement le parfum dont il fait l’éloge. C’est un peu comme si je partageais l’ascenseur d’une personne trop aspergée d’eau de toilette et qui me tousse dessus. En cherchant le mot fragrance sur Google vous serez au mieux dirigé vers le site de Sephora ou de Planet parfum, et au pire vers un certain site anglais qui confine à la pornographie.
 En littérature, il me suffit d’un mot comme celui-ci dans un texte pour qu’au lieu de suivre tranquillement le fil des lignes de mon livre, j’y trouve un petit nœud qui, sans arrêter vraiment ma lecture, me gratte un peu la peau. Certains écrivains facétieux ne peuvent d’ailleurs pas s’empêcher d’employer fragrance à contresens : La poignante fragrance de fauve qui s’étalait en nappes épaisses dans l’atmosphère de la pièce, une pathétique odeur de colique rentrée (Raymond Queneau, Pierrot, exemple donné par le dictionnaire CNRTL).
En littérature, il me suffit d’un mot comme celui-ci dans un texte pour qu’au lieu de suivre tranquillement le fil des lignes de mon livre, j’y trouve un petit nœud qui, sans arrêter vraiment ma lecture, me gratte un peu la peau. Certains écrivains facétieux ne peuvent d’ailleurs pas s’empêcher d’employer fragrance à contresens : La poignante fragrance de fauve qui s’étalait en nappes épaisses dans l’atmosphère de la pièce, une pathétique odeur de colique rentrée (Raymond Queneau, Pierrot, exemple donné par le dictionnaire CNRTL).
Il n’y a pas loin du Capitole à la roche tarpéienne et des jardins de Sémiramis au cloaque.
Dans ces moments je délaisse le français pour me tourner vers l’italien dont les roulades ont plus d’allure que nos grasseyements crachotants : Entrava ella « fragrrrante », chante l’amant désespéré de Tosca. Puis je me tourne vers l’espagnol et je note que mon dictionnaire royal et académique renvoie fragrante à fragante et fragrancia à fragancia. Dans le monde hispanique on se contente de la fragancia pour s’enivrer du parfum des roses et la poésie n’y perd rien :
Yo supe de dolor desde mi infancia,
mi juventud… ¿fue juventud la mía?
Sus rosas aún me dejan su fragancia
una fragancia de melancolía.
Rubén Darío, Chants de vie et d’espérance
« Les roses de ma jeunesse me laissent una fragancia de melancolía ̶ mais ai-je eu une jeunesse ? ̶ » se demande mélancoliquement le poète nicaraguayen.