Quand on parle de vache…
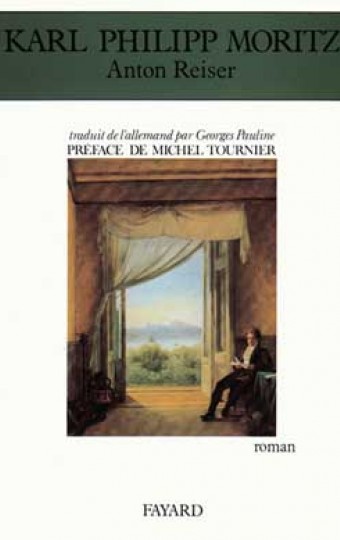 … on en voit le veau. P., connaissant mon récent intérêt pour les vaches de Gombrowicz, m’a fait découvrir l’autre jour un beau texte de Karl-Philipp Moritz (1756-1793). Ce successeur de Rousseau et précurseur du romantisme allemand reste assez méconnu en France. Le personnage éponyme du roman Anton Reiser est un jeune homme sensible, poreux, plongé dans l’immédiateté indéchiffrable de ce qu’il vit, et qui voudrait, lorsqu’il croise un inconnu dans la rue, « traverser la paroi qui séparait des siens les souvenirs et les pensées de cet étranger ». Il en va de même avec les animaux qu’il voit abattre :
… on en voit le veau. P., connaissant mon récent intérêt pour les vaches de Gombrowicz, m’a fait découvrir l’autre jour un beau texte de Karl-Philipp Moritz (1756-1793). Ce successeur de Rousseau et précurseur du romantisme allemand reste assez méconnu en France. Le personnage éponyme du roman Anton Reiser est un jeune homme sensible, poreux, plongé dans l’immédiateté indéchiffrable de ce qu’il vit, et qui voudrait, lorsqu’il croise un inconnu dans la rue, « traverser la paroi qui séparait des siens les souvenirs et les pensées de cet étranger ». Il en va de même avec les animaux qu’il voit abattre :
(…) Pendant toute une période il fut uniquement préoccupé de savoir quelle différence pouvait exister entre lui et ces animaux qu’on abattait. ‒ Souvent il se tenait des heures à regarder un veau, la tête, les yeux, les oreilles, le mufle, les naseaux ; et à l’instar de ce qu’il faisait avec un étranger, il se pressait le plus qu’il pouvait contre celui-ci, pris souvent de cette folle idée qu’il pourrait peu à peu pénétrer en pensée dans cet animal ‒ il lui était si essentiel de savoir la différence entre lui et la bête ‒ et parfois il s’oubliait tellement dans la contemplation soutenue de la bête qu’il croyait réellement avoir un instant ressenti “l’espèce d’existence » d’un tel être. (Traduction Henri-Alexis Baatsch)
« L’espèce d’existence ». On est un bon siècle et demi avant Gombrowicz et deux bons siècles avant Coetzee. (A suivre)
***
Réparer les vivants
L., connaissant mes divagations sur l’écriture et la peau, m’a envoyé une interview de Maylis de Kerangal dans la revue Marie-Claire. Voici ce qu’elle dit :
J’ai éprouvé depuis l’enfance le désir de mettre en mots, de nommer les choses pour les tenir à bonne distance. Oui, pour comprendre et appréhender les situations. Mon hypersensibilité, probablement à la limite du pathologique, a longtemps été inconfortable, paralysante. L’écriture vient de ce besoin de nommer les choses pour qu’elles ne pénètrent pas sous la peau. Elle donne du sens à ma manière d’être.
“Nommer les choses pour qu’elles ne pénètrent pas sous la peau”. Ceci me fait mieux saisir pourquoi je ne me sens pas en affinité avec Maylis de Kerangal tout en reconnaissant la précision de son travail. Je lis dans un commentaire sur Réparer les vivants : “Une parole qui se dépose, qui cristallise”. Un style qui nappe et cisèle… qu’en penserait Karl-Philipp Moritz ?
Sur le même sujet : http://www.lacauselitteraire.fr/peaux-d-ecriture-5-par-nathalie-de-courson

décidément je te suis ou te précède, ainsi j’écris dans un texte sur Flaubert à paraître … un jour: “L’été 1874, tous les préalables à l’écriture de Bouvard et Pécuchet sont terminés, il a trouvé le lieu où il allait les faire vivre, il est temps pour lui d’obéir à son docteur et de penser à sa santé, il part en Suisse et s’y « embête de façon gigantesque », en tous cas, c’est ce qu’il confie à l’autre géant, son ami Tourgueniev, qu’il nommera toujours Tourgueneff : il mange mal, ne voit que des Anglaises et des Allemandes laides, ou des Anglais et des Allemands « munis de bâtons et de lorgnettes » qui jouent aux touristes et le font fuir en rase campagne : « hier, j’ai été tenté d’embrasser trois veaux que j’ai rencontrés dans un herbage, par humanité et besoin d’expansion. » 🙂 🙂 🙂
Hahaha :-))
À TOURGUENEFF.
Jeudi, 2 juillet 1874.
Kaltbad, Rigi, Suisse.
Moi aussi j’ai chaud, et je possède cette supériorité ou infériorité sur vous que je m’embête d’une façon gigantesque. Je suis venu ici pour faire acte d’obéissance, parce qu’on m’a dit que l’air pur des montagnes me dérougirait et me calmerait les nerfs. Ainsi soit-il. Mais jusqu’à présent je ne ressens qu’un immense ennui, dû à la solitude et à l’oisiveté ; et puis, je ne suis pas l’homme de la Nature : «ses merveilles» m’émeuvent moins que celles de l’Art. Elle m’écrase sans me fournir aucune «grande pensée». J’ai envie de lui dire intérieurement : «C’est beau ; tout à l’heure je suis sorti de toi ; dans quelques minutes j’y rentrerai ; laisse-moi tranquille, je demande d’autres distractions. » Les Alpes, du reste, sont en disproportion avec notre individu. C’est trop grand pour nous être utile. Voilà la troisième fois qu’elles me causent un désagréable effet. J’espère que c’est la dernière. Et puis mes compagnons, mon cher vieux, ces messieurs les étrangers qui habitent l’Hôtel ! tous Allemands ou Anglais, munis de bâtons et de lorgnettes. Hier, j’ai été tenté d’embrasser trois veaux que j’ai rencontrés dans un herbage, par humanité et besoin d’expansion. Mon voyage a mal commencé, car je me suis fait, à Lucerne, extraire une dent par un artiste du lieu. Huit jours avant de partir pour la Suisse j’ai fait une tournée dans l’Orne et le Calvados et j’ai enfin trouvé l’endroit où je gîterai mes deux bonshommes. Il me tarde de me mettre à ce bouquin-là, qui me fait d’avance une peur atroce…
Décidément, Marie-Paule et Claude, moi qui prétends que les correspondances d’écrivains sont souvent décevantes, je vais revoir mon jugement !