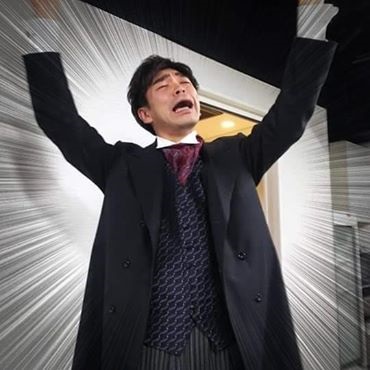En marge de ma note de lecture sur le numéro de la revue Apulée « Traduire le monde » (à paraître à la fin du mois dans La Cause littéraire), je reviens sur une des contributions que je n’avais pas la place de commenter : deux poèmes du Chinois Shu Cai traduits par un collectif de trois personnes, dont une, Yvon Le Men, déclare franchement : « Je ne connais pas le chinois ». Il ajoute :
 Mais je m’intéresse à la Chine depuis cinquante ans et quatre voyages. Par ses empires, ses révolutions, ses poètes, sa cuisine. Et surtout depuis dix ans par mon ami Shu Cai.
Mais je m’intéresse à la Chine depuis cinquante ans et quatre voyages. Par ses empires, ses révolutions, ses poètes, sa cuisine. Et surtout depuis dix ans par mon ami Shu Cai.
Je ne connais pas le chinois, je n’ai donc pas traduit ses poèmes mais je les ai adaptés à la langue française, surtout à ma langue française (p. 238).
Au cours du travail, il téléphone souvent à Shu Cai, qui lui dit en français : « J’ai même recoupé mes poèmes pour suivre ton rythme dans la traduction ». Comme Georges-Arthur Goldschmidt disait dans La Joie du passeur : “Le traducteur doit être l’auteur écrivant dans l’autre langue,” l’auteur devient à son tour le traducteur écrivant dans sa propre langue. Magnifique symbiose !
Si ces remarques m’intéressent, c’est parce que j’ai été confrontée à quelque chose d’un peu comparable : mon amie japonaise Akiko m’a demandé il y a un an de l’aider à revoir sa traduction en français de quelques récits d’une écrivaine des années 20, le japonais étant aussi une langue que je ne parle pas. Notre tâche s’est avérée plus difficile que nous le pensions et ce texte d’Apulée m’a aidée à comprendre pourquoi.
Première différence avec Yvon Le Men : je n’ai pas eu de rapport direct avec l’auteure (morte il y a presque cent ans), non plus qu’Akiko qui se trouve en situation de traductrice, avec tous les tâtonnements que cela suppose, de sa langue maternelle vers une langue qu’elle pratique quotidiennement depuis plus de trente ans mais qu’elle ne ressent pas comme sienne. Certaines expressions qu’elle me présente ont souvent une étrangeté qui leur donne une beauté poétique. Je lui demande alors : « L’intention de l’auteure est-elle poétique ? » Quand la réponse est “non” je me résigne, pour ne pas donner dans un japonisme artificiel, à remplacer une expression fleurie et ravissante par une tournure un peu plus banale… “Le geste de la traduction, c’est l’expérience de la perte”, dit Souleymane Bachir Diagne dans le même numéro d’Apulée.
Deuxième différence – de taille – avec Yvon Le Men : non seulement je ne parle pas le japonais, mais je n’ai pas cinquante ans d’intimité avec le Japon. Je ne m’y suis à vrai dire rendue que trois semaines dans ma vie, juste assez pour m’apercevoir des immenses différences entre nos deux continents. Ma connaissance de la littérature et de la civilisation japonaise reste également limitée, mais ce sont surtout les réalités simples que je ne suis pas apte à bien me représenter : la lumière, les choses qu’on touche, l’air qu’on respire, les voix qu’on entend… Et c’est si important !
A propos de voix qu’on entend, un exemple précis me vient en tête : une vieille femme d’un récit dit à une petite fille : « Tu te prends pour un benshi ! ». Akiko m’explique que le benshi, traduit dans les dictionnaires par bonimenteur, est un personnage de commentateur-acteur qui a joué un rôle de premier plan dans le cinéma muet japonais, et je la sentais insatisfaite par ce bonimenteur. Quelques semaines plus tard, je me rends à la cinémathèque pour assister au film d’ouverture de la rétrospective Cent ans de cinéma japonais qui s’est donnée l’automne dernier à Paris. Et là, je vois, j’entends le benshi Raïko Sakamoto en chair et en os, invité par les organisateurs alors qu’il ne reste plus qu’une dizaine de benshi au Japon ! C’est un acteur extraordinaire qui mime, commente et donne les répliques du film en modulant sa voix de multiples façons. J’avais l’impression que tout le Japon était magiquement devenu voix, et sans saisir ses paroles, j’ai compris à ce moment que la gamine du récit était extrêmement insolente et culottée de se prendre pour un personnage aussi considérable.
Je ne sais plus si nous avons choisi le mot « bonimenteur » pour traduire benshi, mais une image précise s’est formée dans ma tête, et tout commence par là.
On y arrivera.