… disait Beckett à Charles Juliet. Je me rappelle assez souvent cette phrase, notamment en ces mois de septembre-octobre 2019, en partie consacrés pour moi à « Nathalie Sarraute vingt ans après ».
Après avoir assisté à la conférence d’Anne Jefferson à la MAHJ et à une partie du colloque du 18 octobre, avoir relu certaines œuvres et en avoir tiré trois « articulets » (comme dirait Robert Walser), je crois que ce travail m’a donné un peu de plaisir, mais aucun nouvel élan. Je me suis même aperçue que mes propos d’il y a quelques jours sur ce blog étaient presque identiques, en plus détaillés, à des notes esquissées en 2016 que j’avais complètement oubliées, et c’est alors que la phrase de Beckett m’est revenue en mémoire.
Mais il arrive que lorsqu’on renonce à prendre les choses de front, des éléments latéraux et en apparence futiles viennent faire notre bonheur. Sans que je m’en doute sur l’instant, ce que j’ai le plus retenu de la conférence d’Ann Jefferson c’est, dans un petit film préliminaire qui a été coupé au bout de cinq minutes pour défaillance technique (et que j’avais déjà vu il y a longtemps), l’image de Nathalie Sarraute avec ses cheveux gris coupés au carré, vêtue de sa canadienne, quitter son domicile pour aller travailler au café. Et cette image m’a si bien marquée que je me retrouve depuis plusieurs matinées dans un café calme et spacieux de mon quartier, où je lis et annote en rêvant dans les marges les passionnantes conversations de Murakami avec Seiji Ozawa, devant un café long accompagné d’une mini viennoiserie.
Ce café appartient à un hôtel avec une atmosphère internationale assez feutrée, des allées et venues, des valises, des langues de partout, des accents multiples en français, et aussi des rendez-vous de cadres d’entreprise auxquels je vole avec un rire intérieur des bribes de conversations : « Vous comptez beaucoup sur votre intelligence émotionnelle » ; « je vais monter en dominance », pendant que ma lecture me transporte avec Ozawa et ses orchestres à Tokyo, à Boston, à Toronto, à Vienne, à Berlin… Tout ceci à dix minutes de chez moi. Les serveurs maintenant me reconnaissent et me sourient, et ce mélange de départs et d’arrivées, d’ici et d’ailleurs, de psychologie entrepreneuriale, de littérature et de musique, me donne l’impression de prendre place dans un avion qui décolle pour m’éloigner, « et d’elle et de moi ».

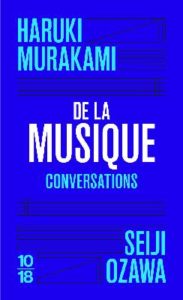
deviendrais-tu mélancolique Nathalie? 🙂
Le ton du billet est mélancolique ? Je me sens au contraire très heureuse dans ce café où j’ai autant de plaisir à retrouver Ozawa et Murakami que s’ils étaient mes amants.
En revanche, il est difficile (en tout cas pour moi) de tirer quelque chose de neuf d’un objet d’étude ancien. Même si mon admiration pour “Tu ne t’aimes pas” est toujours aussi fraîche, ce n’est pas évident d’avoir des mots nouveaux pour la dire.
pour fêter les 101 ans d’Obaldia aujourd’hui, j’ai mis sur mon mur FB un petit texte d’Obaldia : “Congratulations!
D’habiter la même planète, à la même époque – une fraction minuscule de temps comprise entre des milliards de siècles – et miracle! de se rencontrer tout de go dans la rue, au restaurant, à l’église, aux Folies-Bergère, dans l’ascenseur (“Ah! c’est toi!… – Ah! c’est nous…”), ne devrions-nous pas nous jeter dans les bras les uns des autres, balbutiant, riant et sanglotant, et nous lancer quelques compliments?”
Je pensais à toi, dans ton café, et à ce que tu pourrais provoquer si tu tendais ainsi les bras à tous ceux qui passent 🙂
Je vais lire ce texte.