La prose de Michel Leiris m’endort parfois, et soudain vrombit et me pique comme un moustique.
S’il est amateur de calembours et de mots déformés, Leiris juge avec sévérité les “plates atteintes au langage” que sont les argots familiaux, ces mots qui, loin de suggérer des associations inédites, servent à reconnaître les moutons du même troupeau.
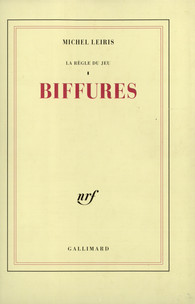
Entre gens qui se voient journellement, il se crée fatalement des habitudes ; chacun se fige dans une attitude définie, née de la conception que les autres ont de lui ; chacun aussi a ses spécialités, ses « numéros ». C’est cela que je ne peux pas supporter, cela que je regarde comme un indice de momification et de gâtisme. (p. 189)
Issue d’une famille nombreuse j’ai moi-même, je l’avoue, abondamment pratiqué (et ce n’est pas fini) ces argots convenus des couvées familiales qui donnent à ses membres la sensation douillette d’être serrés les uns contre les autres sous une couette qui sent la poule. Enfant, je m’estimais heureuse que mon grand-père me distingue en m’appelant “Nathaloche”. Adolescente, j’ai adopté le jargon du clan contigu de mes cousines, “fillasses chéries” d’une tante collectionneuse de néologismes fantaisistes et de suffixes tendrement dépréciatifs. Avec mes frères et sœurs j’ai partagé divers hispanismes, puis un dialecte dissident et blasphématoire qui consistait à parsemer de grossièretés certaines expressions parentales et grand-parentales.
Les paroles si justes de Leiris me sont des injonctions à secouer toutes ces plumes et à suspendre ma couette de mots familiaux à la fenêtre. Que perdrai-je si un coup de vent l’emporte ?
