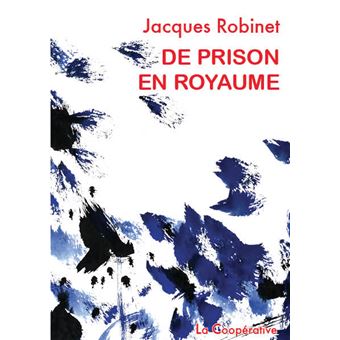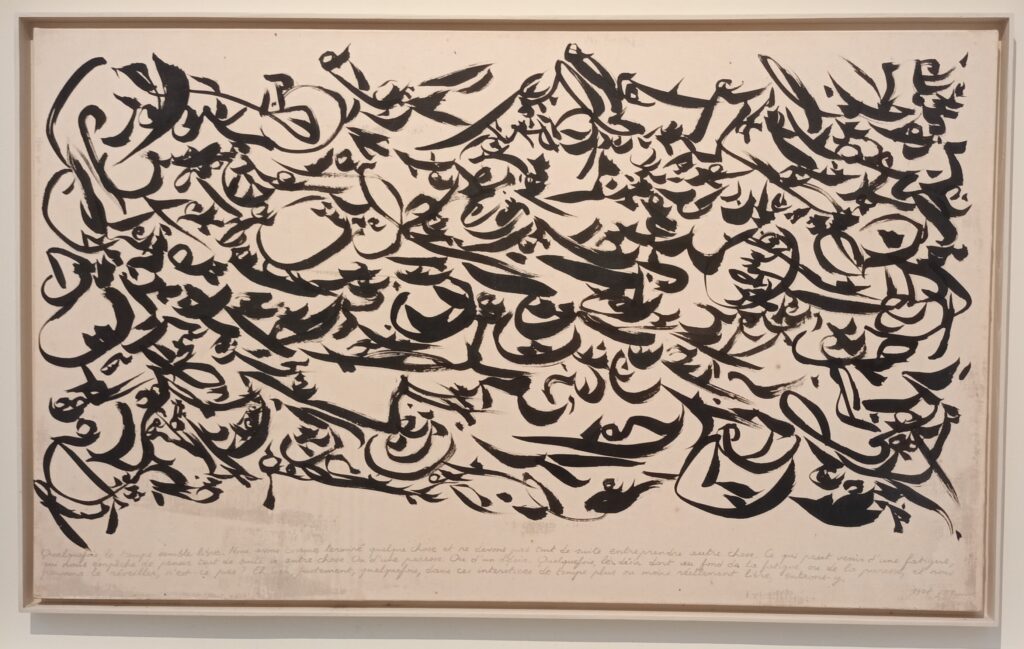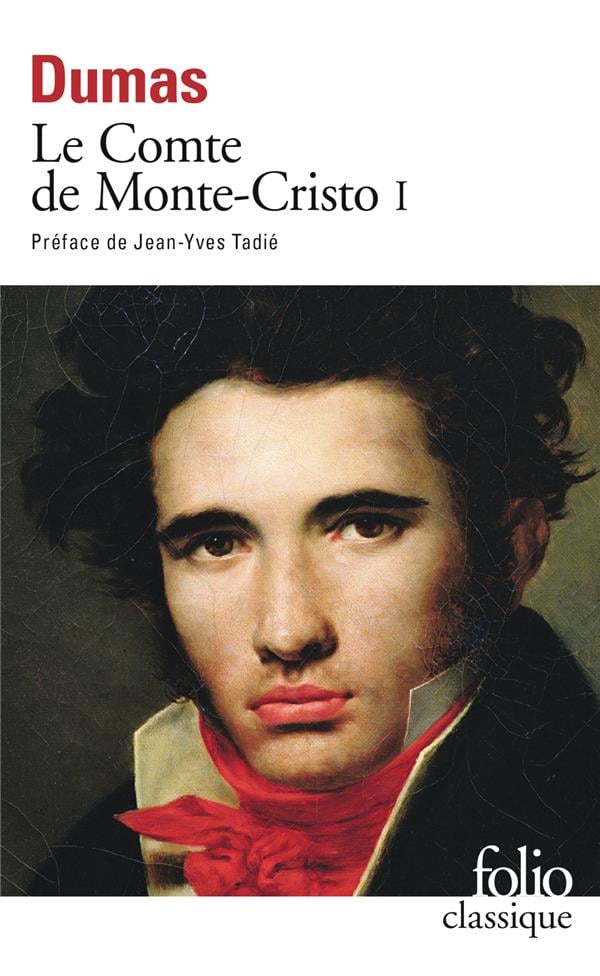Sur la plage

Au bout du sentier qui mène à la plage il y avait un arc-en-ciel beaucoup plus beau que sur la photo. Côté Cabourg, la mer était d’un vert lumineux et profond.
J’ai ramassé un galet ovale parfait comme un œuf de mouette. Je choisis désormais les galets pour leur forme. Je ne me laisse plus prendre à leur éclat car je sais que tout ce qui brille sur la plage n’est plus or à la maison. (Comme les idées lumineuses d’insomnie qui ne sont au matin que cadavres de taupes.)
Puis j’ai compté quelque chose sur les doigts de la main. J’ai oublié ce que j’ai compté mais j’ai toujours trois doigts dressés. Et je ne retrouve plus mon galet ovale.
De prison en royaume
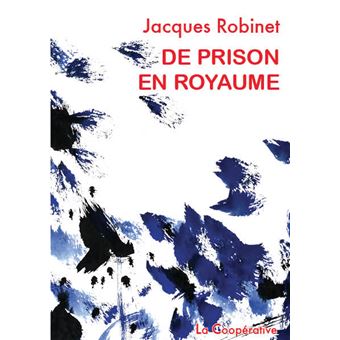
Ce blog est désormais privé des beaux commentaires de Jacques, mais il reste ses livres dont je picorerai des phrases de temps en temps. Voici un extrait du dernier, publié le 3 octobre 2025.
Pourquoi tel livre m’emprisonne-t-il quand tel autre me libère ? (…) Pour me surprendre et me réjouir, il faut que tout suggère sans s’imposer, et que la pensée qui m’invite à la suivre soit trébuchante, capable d’avouer son ignorance malgré sa fermeté. (…) C’est peut-être une des raisons qui me fait aimer les textes fragmentaires, pleins d’incomplétude, de questions sans réponse immédiate, de déchirures et de trous.
La fin du paragraphe est comme un arc-en-ciel d’automne découvert au bout du sentier :
Plus que tout, j’aime la surprise de brindilles qui s’enflamment. L’important, ce n’est pas le chemin goudronné, mais le feu qui jaillit à l’improviste et le voleur qui s’en empare.
Je kiffe
Un feu d’artifice a d’ailleurs jailli pendant cette promenade de plage : un jeune homme est sorti de la mer en short et t-shirt, rayonnant de joie. Je lui ai demandé si l’eau était froide. Il m’a répondu : « Non, c’est la meilleure mer, je kiffe, je kiffe… J’ai fait mon footing puis je me suis jeté à l’eau. La meilleure mer, c’est maintenant et en janvier ! Je kiffe ! » Le long de la promenade, les personnes assises sur des bancs avaient irrésistiblement envie de le féliciter tant il respirait l’enthousiasme. Et à tous il répondait : « C’est la meilleure mer, je kiffe, je kiffe ! »