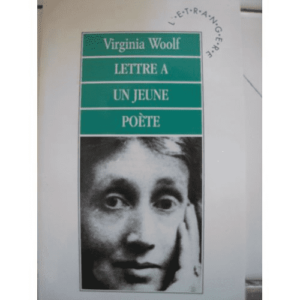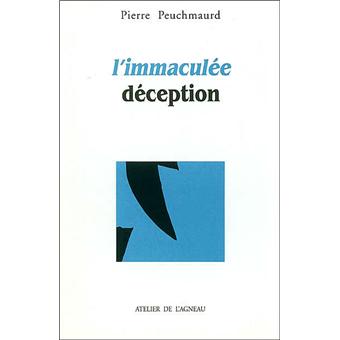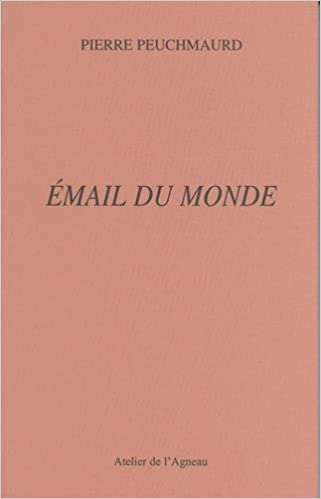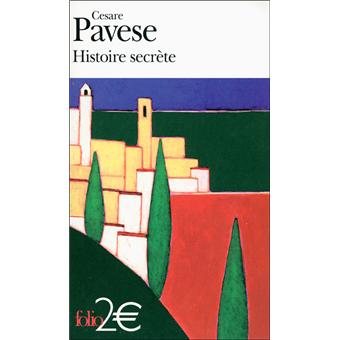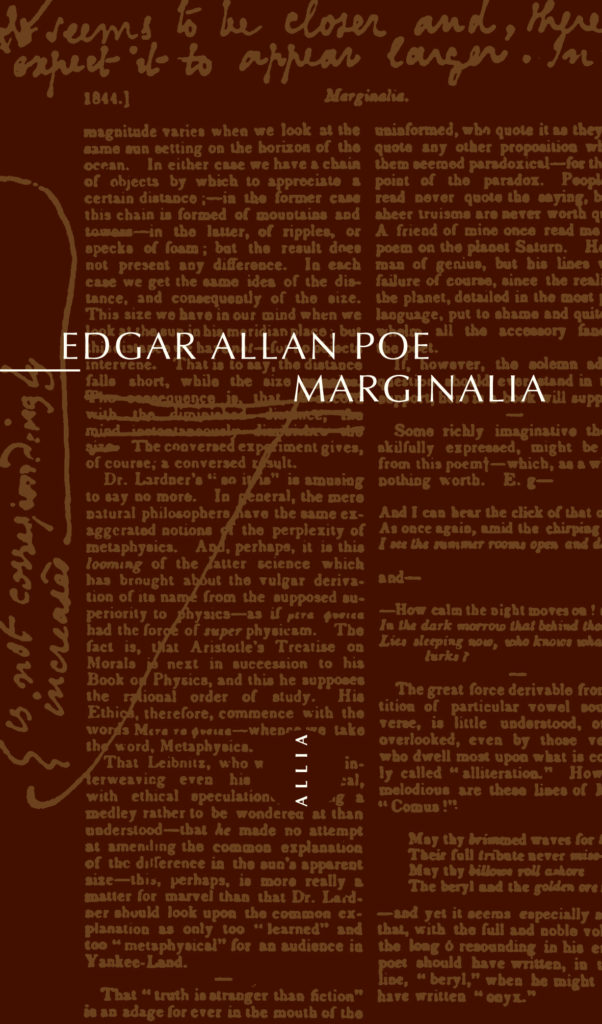Pour Lulu
Hélène Hoppenot raconte dans son Journal (éditions Claire Paulhan) que la femme d’un diplomate collègue de son mari nommait fièrement, en bonne pondeuse, ses enfants : “Mon numéro un, mon numéro deux, cinq, six, etc.”, et je me souviens que maman critiquait cette pratique assez courante. Il faut dire qu’avant que la contraception ne se développe librement dans nos pays, les couples qui ne pratiquaient ni l’abstinence ni le coïtus interruptus (et encore moins l’avortement) avaient parfois, dans les premiers temps de leur mariage, un enfant par an pendant trois ou quatre ans. Puis ils se calmaient et entamaient de manière mieux planifiée leur deuxième série d’enfants. Les grands constituaient donc un groupe bien distinct des petits.
Dans une famille nombreuse chaque enfant porte, profondément ancré en lui, le numéro qu’il occupe dans la fratrie. S’il m’est arrivé dans un récit d’appeler mes personnages Triolette, Quartette et Quintette, c’est donc autant par réalisme social que par motif musical.
Être le dernier des grands, affirmais-je péremptoirement à trois heures du matin (on est souvent péremptoire dans les insomnies), n’est pas très avantageux, car les yeux tournés vers les plus grands, on est dédaigné d’eux tout en partageant leur dédain pour les petits. En revanche, quand on est l’aîné des petits on sait qu’on n’est qu’un chétif insecte aux yeux des grands. On peut alors se tailler la première place dans les sphères inférieures avec une liberté d’autant plus grande que les regards des dieux parentaux sont eux aussi lourdement fixés sur les aînés. Est-il aussi avantageux d’être le dernier des derniers, né inopinément 10 ans après le faux dernier et chouchouté par toute la famille ? Pas sûr, car tout en étant adulé par maman et papa, ce tardillon est chargé de réaliser toutes les espérances que les aînés ont déçues.
Ces propos feront bâiller d’ennui quiconque n’appartient pas à une famille nombreuse ou a décrété depuis longtemps : “familles je vous hais”. Mais ce que j’avance ne peut-il pas s’appliquer à d’autres domaines ? me dis-je maintenant, à 11 h du matin. Vaut-il mieux faire partie du bas de la haute ou du haut de la basse ? Le dernier violon du Boston Symphony Orchestra est-il plus heureux que le chef de l’Harmonie municipale de Mézidon-Canon ?
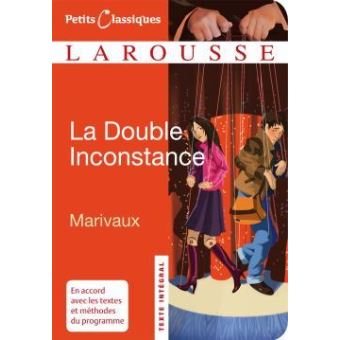 Inépuisable sujet de comédie. “Une bourgeoise, contente dans un petit village, vaut mieux qu’une princesse qui pleure dans un bel appartement”, dit à l’acte I scène 1 de La Double inconstance Silvia, qui deviendra à l’acte III scène 10 une princesse contente dans un bel appartement.
Inépuisable sujet de comédie. “Une bourgeoise, contente dans un petit village, vaut mieux qu’une princesse qui pleure dans un bel appartement”, dit à l’acte I scène 1 de La Double inconstance Silvia, qui deviendra à l’acte III scène 10 une princesse contente dans un bel appartement.