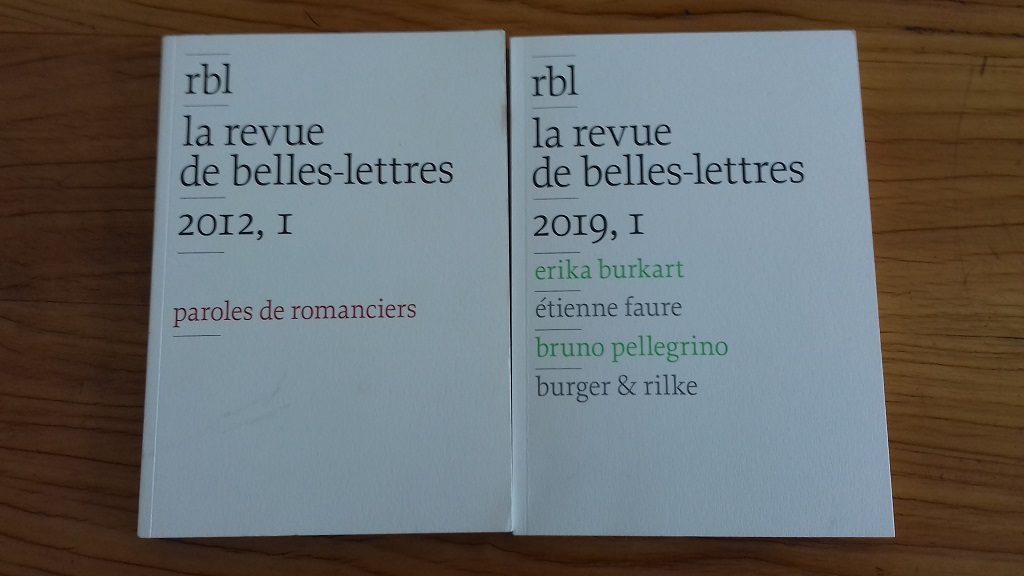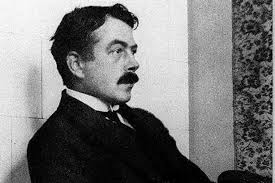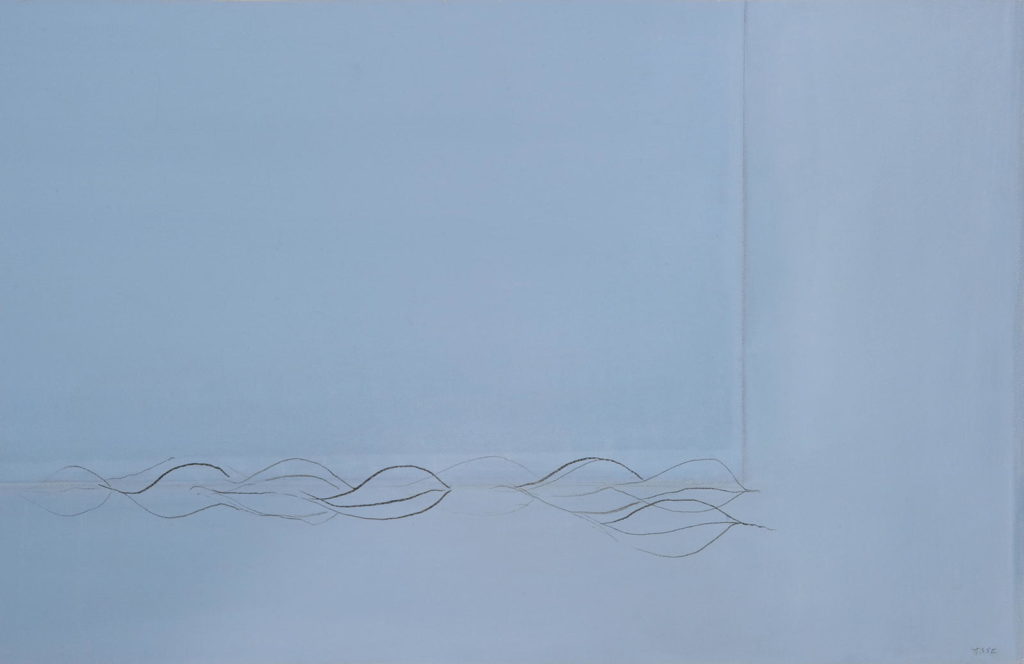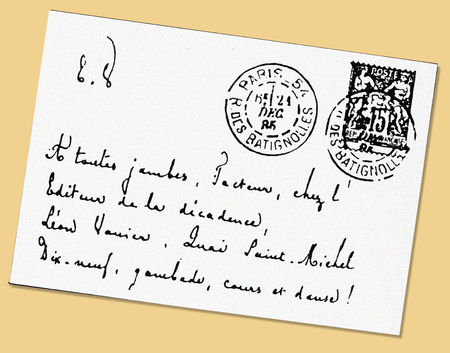Il y a des amies à éclipses qui, sans être le moins du monde dédaigneuses, interposent entre elles et moi un petit nuage blanc qu’elles dissipent ensuite affectueusement.
R. répond rarement à mes courriers, mais elle me propose soudain un restaurant original, règle intégralement la note, rit à toutes mes plaisanteries, me comble de compliments sincères qui me prouvent indéniablement qu’elle me voit « du bon côté ». Et j’ai l’impression d’être l’enfant d’une diva qui, entre deux tournées, couvre sa fille chérie de baisers parfumés et de cadeaux exotiques.
V. ma soeur/cousine/amie d’enfance est chaleureuse, mais certains des regards qu’elle pose sur moi me rappellent le commentaire de maman quand j’avais trente-cinq ans, un tee-shirt panthère, et pas encore d’enfant : « Nathalie est presque fraîche ».
Je me garderai d’imaginer quel « presque » je suis devenue pour ma sœur/cousine/amie d’enfance, et je me garderai en général d’imaginer les « presque » de mes amies, me souvenant de Pascal : « Je mets en fait que si tous les hommes savaient ce qu’ils disent les uns des autres, il n’y aurait pas quatre amis dans le monde » (Pensées, éd. Le Guern, 655).
A suivre.