J’ai relu récemment Cuisine (2012) d’Antoine Emaz, ensemble de notes modestes, observations familières sur le quotidien, réflexions marginales où le travail d’écrire n’est jamais perdu de vue.
J’ai besoin de ces lectures qui n’intimident pas, comme je voudrais en ce moment que mes « pattes de mouette » ressemblent aux propos que maman nous confiait en s’essuyant les mains après la vaisselle, et qui commençaient toujours par : « Au fond… ».
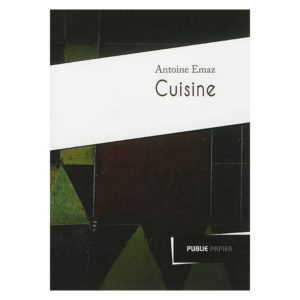 Je trouve par exemple dans Cuisine : « Un type qui a professionnellement réussi ou raté devient souvent détestable. L’un marine dans l’aigreur ulcéreuse, l’autre dans les leçons de morale à tout va. Celui qui n’a pas réussi mais pas raté non plus reste simplement joyeux de vivre encore, et c’est bien suffisant, pour lui et pour les autres ».
Je trouve par exemple dans Cuisine : « Un type qui a professionnellement réussi ou raté devient souvent détestable. L’un marine dans l’aigreur ulcéreuse, l’autre dans les leçons de morale à tout va. Celui qui n’a pas réussi mais pas raté non plus reste simplement joyeux de vivre encore, et c’est bien suffisant, pour lui et pour les autres ».
Au fond, je me sens comme ce type-là : ni réussie ni ratée, essayant de conserver à travers mes âges ma petite gaieté.
On vérifie aussi dans ce livre que c’est la sensation – « l’émotion » ou « le vivre », dirait-il – qui tire l’écriture poétique, comme chez les écrivains que je préfère. Exemple : « Il faudrait dire la nuit, non pas accueillante, mais la nuit mur, la nuit qui renvoie. Ici, devant, ce soir, les vitres sont d’un noir opaque qui reflète la table et la lampe. Aucun envol lyrique possible ». Or le premier poème d’Antoine Emaz que j’ai lu il y a une quinzaine d’années – sur lequel mon œil a buté avec étonnement – s’appelle « Poème du mur », au début du recueil Caisse claire.
 Dans les dernières pages, Emaz évoque une émission de France-Culture où l’invité, Jean-Pierre Richard, fait un « salut final » à Starobinski sur la question de la bonne distance entre le lecteur et le livre (celle que je cherche en ce moment pour lire Emaz). Il est étrange de penser qu’Antoine Emaz, Jean Starobinski et Jean-Pierre Richard, rassemblés dans cette Cuisine, sont morts à quelques jours d’écart il y a un an : le 3, le 4 et le 15 mars 2019.
Dans les dernières pages, Emaz évoque une émission de France-Culture où l’invité, Jean-Pierre Richard, fait un « salut final » à Starobinski sur la question de la bonne distance entre le lecteur et le livre (celle que je cherche en ce moment pour lire Emaz). Il est étrange de penser qu’Antoine Emaz, Jean Starobinski et Jean-Pierre Richard, rassemblés dans cette Cuisine, sont morts à quelques jours d’écart il y a un an : le 3, le 4 et le 15 mars 2019.
N.B. Certains de mes abonnés ont pu lire sur leur boîte mail, daté du 15 avril, un billet (ou le « teaser » d’un billet) intitulé « Une lecture épidémiste de Mrs Dalloway ». Ce billet est à présent indiqué « introuvable » et je m’en excuse : je l’ai mis à la corbeille car je ne suis plus vraiment d’accord avec l’interprétation, par d’éminents universitaires américains, de Mrs Dalloway à travers la pandémie de grippe de 1918. L’idée est amusante et rejoint une de mes interrogations, mais elle ne tient pas la route très longtemps : pour Clarissa Dalloway, ravie de marcher en juin 1918 dans un Londres tranquille et resplendissant après quatre ans et demi de guerre, la grippe qui a blanchi son teint et affecté son débit cardiaque est un phénomène secondaire. On n’avait pas alors la même sensibilité à la maladie et à la mort qu’aujourd’hui.
L’historien Stéphane Audoin Rouzeau m’a aidée à le comprendre :
https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-des-matins/stephane-audoin-rouzeau-est-linvite-des-matins



Merci pour ces textes et tes découvertes.
Merci pour ta lecture régulière de mes “pattes”, et bon travail !