Pour la deuxième fois je commence l’année avec George Eliot, comme on aime la conversation d’une amie pétillante l’hiver au coin du feu. Et sans m’en rendre compte je lui applique sur mon cahier les mêmes mots qu’il y a deux ans sur Middlemarch : “Pertinence, acuité ” (voir lien ci-dessous).
Le Moulin sur la Floss (1860) est à la fois un roman réaliste sur une campagne anglaise gagnée dans les années 1830 par la révolution industrielle, un récit poétique dont l’eau est le principal élément, et un roman d’éducation autour des personnages de Tom Tulliver et de sa jeune sœur Maggie.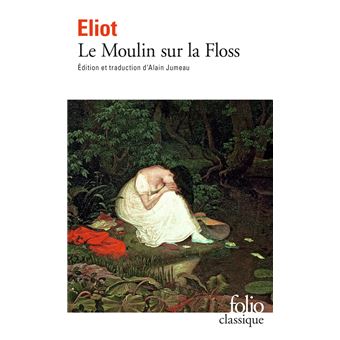 Je ne me croyais plus capable d’éprouver un élan de sympathie adolescente envers un personnage de roman comme s’il s’agissait d’un être réel, mais celui de Maggie dans les premières parties du livre m’a émue si fort que j’éprouve l’envie de citer ici quelques lignes qui la concernent.
Je ne me croyais plus capable d’éprouver un élan de sympathie adolescente envers un personnage de roman comme s’il s’agissait d’un être réel, mais celui de Maggie dans les premières parties du livre m’a émue si fort que j’éprouve l’envie de citer ici quelques lignes qui la concernent.
Tom, le grand frère, est un gars de la campagne orienté vers les choses de la nature. Maggie, qui lui voue une grande admiration, est imaginative et tournée vers les livres. Leur père, un meunier, estime que Tom doit recevoir une éducation qui lui permette un jour de devenir notaire, et le met en pension chez un pasteur, M. Stelling. On lui enseigne la géométrie et le latin pour lesquels l’enfant n’a aucune disposition. Maggie, autorisée à passer une semaine près de son frère, se passionne pour ses livres et tente de comprendre les déclinaisons et les théorèmes. Tom un peu inquiet demande au pasteur :
« — Les filles peuvent pas apprendre la géométrie, hein, Monsieur ?
— Elles peuvent glaner un peu de tout, je crois bien, dit M. Stelling. Elles ont beaucoup d’intelligence superficielle, mais elles ne pourraient pas aller loin dans aucune branche. Elles ont l’esprit vif, mais sans profondeur. »
Tom, ravi de ce verdict, exprima son triomphe, derrière la chaise de M. Stelling, en adressant à Maggie des signes de tête, qui avaient une fonction télégraphique. Quant à Maggie, elle n’avait jamais été aussi mortifiée. Elle était si fière que l’on dise qu’elle était « vive », pendant toute sa courte vie, et voilà que maintenant sa vivacité semblait être la marque de l’infériorité.
George Eliot partage très probablement les qualités de son héroïne (elle lisait assidûment les livres de la bibliothèque du manoir dont son père était régisseur et avait elle aussi un grand frère), mais contrairement à ce que suggère Virginia Woolf dans son article Les Femmes et le roman, je ne note pas dans ses propos le souci de plaider la cause des femmes. Les tantes de Tom et Maggie portent en elles toutes les nuances de stupidité, de sensiblerie ou de méchanceté. Eliot possède en revanche un art de pénétrer l’âme de ses personnages, notamment la détresse ordinaire d’une petite fille, que je ne rencontre pas tous les jours dans la littérature.

ta première et ta dernière phrases me renvoient très exactement à ce que j’ai éprouvé hier en relisant avec un grand plaisir “un oiseau dans la maison” de Margaret Laurence, un livre acheté par hasard il y a quelques années dans une solderie plus pour son éditeur que pour son auteure une romancière canadienne anglaise publiée par les éditions Picquier en 1989 juste après sa mort et qui était totalement inconnue de moi.
Merci Marie-Paule ! Inconnue de moi aussi. Je ne vois plus le livre dans le catalogue de Picquier, mais on le trouve dans une bibliothèque du 13ème arrondissement de Paris. Elle a donc le “quelque chose” elle aussi ? D’après ce que je viens de voir, elle est très célèbre au Canada.
oui, j’ai vu aussi qu’elle était célèbre au Canada, je ne sais pas du tout ce que valent ses autres livres mais celui-là qui semble plus ou moins autobiographique est passionnant et a aussi ce “quelque chose” disons à la fois d’exotique et d’universel 🙂