Quel espoir me donne chaque livre que je lis, ou plutôt que j’ouvre ? Peut-être qu’il me révèle le secret d’une origine, et aussi me suggère un but vers lequel tendre. Un vent qui me pousse en avant.
Quel espoir me donne chaque livre que je lis, ou plutôt que j’ouvre ? Peut-être qu’il me révèle le secret d’une origine, et aussi me suggère un but vers lequel tendre. Un vent qui me pousse en avant.
Comment, au cours de mes promenades littéraires, ne pas rencontrer l’art du toucher par excellence : la sculpture ? Je ne me réfère pas aux ateliers qui font aujourd’hui travailler des équipes loin du sculpteur-concepteur, mais, très loin de ces tendances, à Giuseppe Penone.
Son oeuvre a été définie, à l’exposition qui eut lieu en 2004 au Centre Pompidou à Paris, comme un « art du contact » :
(…) contact de l’homme avec le monde, de la peau avec les objets, du regard avec la nature, mais aussi reprise du contact de l’homme avec lui-même, de l’artiste avec l’homme. (Bruno Racine, Préface du Catalogue de l’exposition, p. 39)
Penone accompagne son œuvre sculpturale de rêveries ou poèmes en prose faisant état de ses affinités avec la matière.
 Je sens la respiration de la forêt,
Je sens la respiration de la forêt,
j’entends la croissance lente et inexorable du bois,
je modèle ma respiration sur la respiration du végétal,
je perçois l’écoulement de l’arbre autour de ma main
posée sur son tronc. (p. 17)
Ne dirait-on pas un poème de Guillevic ?
A certains moments la pratique de l’art ressemble à un rituel avec ses gestes spécifiques :
Pour réaliser la sculpture, il faut que le sculpteur se mette à son aise,
qu’il s’allonge par terre en se laissant glisser, sans descendre trop vite ;
doucement, peu à peu, et enfin, une fois en position horizontale,
qu’il concentre son attention et ses efforts sur son corps qui,
en contact étroit avec le sol, lui permet de voir et de sentir
contre lui les choses de la terre ; il peut ensuite écarter les bras
pour profiter pleinement de la fraîcheur de la terre
et atteindre le degré de tranquillité nécessaire
à l’exécution de la sculpture. (p. 32)
Penone est également très sensible aux empreintes qui se superposent sur les objets du monde :
 (…) sur les banquettes de trains, sur les manches des pioches, sur les rampes, sur les barres de tramways (…) », sur tout ce qui « délimite un contact antérieur, indique les points de l’espace que les expériences qui nous ont précédé conseillent de toucher. (p. 72)
(…) sur les banquettes de trains, sur les manches des pioches, sur les rampes, sur les barres de tramways (…) », sur tout ce qui « délimite un contact antérieur, indique les points de l’espace que les expériences qui nous ont précédé conseillent de toucher. (p. 72)
Comment vit-il l’excentricité tactile de notre époque ? Avec patience et d’un peu loin, je suppose.
L’absence de bords entraîne l’effroi. Baudelaire, notamment, aime pour ses “tableaux parisiens” les bords et les cadres car sans eux les fantômes ne sont plus contenus. Un poème des Fleurs du Mal auquel je pense quelquefois est “Les Sept vieillards” : dans une rue parisienne enveloppée d’un brouillard jaunâtre et sale où rien ne se distingue de rien, apparaît un vieillard « dont les guenilles jaunes/ Imitaient la couleur de ce ciel pluvieux ». Il n’avance pas seul : « Son pareil le suivait ». Puis :
A quel complot infâme étais-je donc en butte,
Ou quel méchant hasard ainsi m’humiliait ?
Car je comptai sept fois, de minute en minute,
Ce sinistre vieillard qui se multipliait !
Le poète atterré finit par « tourner le dos au cortège infernal » de ces figures du mauvais infini spleenétique. Il s’enferme chez lui et dit dans la dernière strophe :
Vainement ma raison voulait prendre la barre ;
La tempête en jouant déroutait mes efforts,
Et mon âme dansait, dansait, vieille gabarre
Sans mâts, sur une mer monstrueuse et sans bords !
J’aime particulièrement « sans mâts » (dont se souviendra Mallarmé dans “Brise marine”), avec le rejet qui mime – sans dégât pour l’équilibre des vers – cette perte des bords et des repères. Dans mon exemplaire des Oeuvres complètes de Baudelaire aux pages jaunies (qui date de 1961), le point sur le i et le t du deuxième « dansait » sont un peu effacés ainsi que la virgule qui suit, comme si le bord des mots lui-même se fondait dans le paysage effrayant évoqué par le poème.
En lisant “Les sept vieillards”, j’ai en tête la teinte jaune-marron des peintures dites “noires” de Goya que j’ai choisies pour encadrer les vers de Baudelaire.
“Goya, cauchemar plein de choses inconnues” (“Les Phares”)
Sur Baudelaire, les cadres et les bords, un excellent article de Martin Rueff : “Le cadre infini – sur la poétique baudelairienne” https://www.cairn.info/revue-litterature-2015-1-page-21.htm
Cette année le coucou a chanté sans moi.
Mais je l’ai entendu hier en marchant vers la plage,
une petite fois.
Mettons que ce n’était pas un pigeon.
Chaque année je fais un voeu quand j’entends le premier coucou d’avril. Je fais aussi un voeu quand je mange ma première cerise de juin, puis quand je mange ma première noisette de septembre.
Le 1er janvier je fais mon voeu principal et j’adresse “mes meilleurs voeux” à mes proches.
♦ Près de Louviers s’étend la forêt de Bord. Ce nom me rassure toujours enfantinement quand je passe à proximité ; je m’imagine que le Petit Poucet et ses frères n’auraient pas pu s’y perdre.
♦ « Toucher, c’est toucher un bord », dit Derrida (Le toucher, Jean-Luc Nancy).
♦ Guillevic le touchant aime les bords, jonctions, orées, lisières, talus, charnières : “À la charnière, quelle charnière ? / À la jonction, / Pour y creuser.” (Avec).
♦ Lorsque je roulais par temps de neige sur des routes départementales de la Somme et de l’Oise, il arrivait que la chaussée ne se distingue pas des champs. Plus de talus, plus de bas-côté, plus de bord. Si le brouillard s’y ajoutait le monde devenait intenable. Un jour j’ai laissé ma voiture à une gare de campagne pour prendre le train. N’a-t-on pas quelquefois besoin, aussi, de rails ?
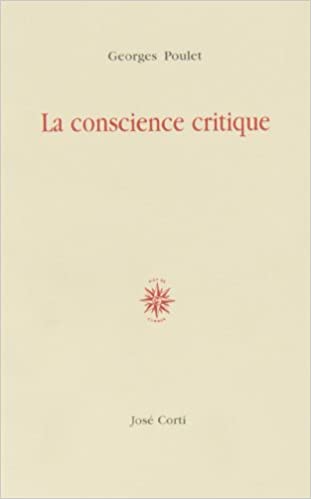 Comment touche-t-on l’œuvre que l’on commente ? Au cours de mes études littéraires j’ai toujours été rebutée par une critique plaquant sur son objet un discours scientifique trop extérieur à lui. J’étais davantage attirée par la « critique de la conscience », définie ainsi par Georges Poulet : « Chacun s’y efforce de revivre et de repenser par soi-même les expériences vécues et les idées pensées par d’autres esprits. » Ceci suppose des variations de distance entre l’auteur et le lecteur, et s’il y a contresens, essayons de faire en sorte qu’il soit beau, conseillerait Proust.
Comment touche-t-on l’œuvre que l’on commente ? Au cours de mes études littéraires j’ai toujours été rebutée par une critique plaquant sur son objet un discours scientifique trop extérieur à lui. J’étais davantage attirée par la « critique de la conscience », définie ainsi par Georges Poulet : « Chacun s’y efforce de revivre et de repenser par soi-même les expériences vécues et les idées pensées par d’autres esprits. » Ceci suppose des variations de distance entre l’auteur et le lecteur, et s’il y a contresens, essayons de faire en sorte qu’il soit beau, conseillerait Proust.
J’ai été frappée par le cas du critique Jacques Rivière, que Georges Poulet décrit comme très peu sûr de lui, conscient de sa faiblesse, et presque maladivement tactile dans son appréhension des œuvres, auxquelles il semble avoir besoin d’adhérer au point d’y fondre la sienne. Poulet le cite:
Je n’aime, je ne comprends, je ne crois que ce que je touche, que ce qui est à la mesure de mes sens et sous ma main, et qui laisse un goût sur mes lèvres… Rien ne m’est prouvé que par le contact.
Puis Georges Poulet commente :
On dirait que chez Rivière le progrès de la connaissance suit une voie qui est celle empruntée habituellement non par les voyants mais par les aveugles : avance à tâtons, suivie d’un contact physique et de l’exploration des surfaces.
Il parle ensuite de « corps-à-corps, d’étreinte imparfaite » afin de faire apparaître « la texture, le grain, la solidité » de l’œuvre lue.
Je suis à mon tour touchée par cette palpation exploratrice, scrupuleuse, sans surplomb et sans annexion. Comment un homme aussi important dans le milieu intellectuel de l’entre-deux-guerres, Directeur de la NRF, un des premiers à avoir apprécié Aragon et Proust, pouvait-il s’oublier à ce point, et pourquoi ne l’ai-je pratiquement pas lu ?
Un numéro récent de la revue Europe lui rend hommage :
https://www.europe-revue.net/produit/n-1082-1083-1084-jacques-riviere-jean-prevost-juin-juil-aout-2019/ (Un article de Jérôme Roger mis en ligne nous y donne un autre aperçu du tact littéraire de Jacques Rivière).
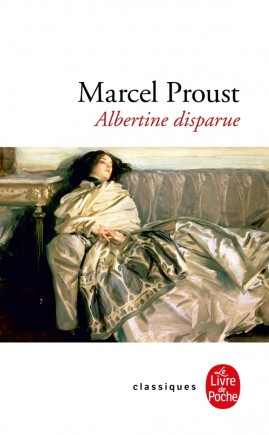 On touche parfois mieux les choses ailleurs qu’en elles-mêmes.
On touche parfois mieux les choses ailleurs qu’en elles-mêmes.
Dans la dernière partie d’Albertine disparue le narrateur se promène autour de Combray, dans les lieux de son enfance qui sont de nouveau à portée de sa main, et se sent désolé de ne pas y revivre ses années d’autrefois. Les éléments du paysage n’ont pas foncièrement changé, mais « il n’y avait pas entre eux et moi cette contiguïté d’où naît avant même qu’on s’en soit aperçu l’immédiate, délicieuse et totale déflagration du souvenir ».
On sait que la grande déflagration aura lieu inopinément dans Le Temps retrouvé, au contact des pavés de la cour de l’hôtel de Guermantes à Paris.
***
Jean-Luc Parant (Machines à voir) :
– « L’homme est à la recherche de ce qui a disparu et qu’il ne peut pas toucher […] À la recherche de ses propres traces intouchables. »
Toute personne qui aime et veut écrire le sait.
– « Quand l’homme touchera ce qui est le plus intouchable et ce qui lui brûle les doigts il ira si loin qu’il disparaîtra », ajoute-t-il.
Il est curieux de voir à quel point la pensée de la mort, liée à la découverte d’un accès possible au temps perdu, hante le narrateur dans les dernières pages du Temps retrouvé. Comme si, au moment de toucher enfin son pan de mur jaune à lui, il craignait de s’écrouler comme Bergotte ?
L’autre soir à la télévision une jeune promeneuse enjouée expliquait au reporter : « Quand tu rencontres quelqu’un qui t’plaît, c’est gênant de lui d’mander au moment de s’embrasser : ‒ Tu vas m’filer l’corona ? »
Cette année la saison des amours semble meilleure pour les oiseaux que pour les humains.
Mais les oiseaux ne connaissent pas les sites de « rencontre virtuelle » dont la fréquentation était en grande hausse ces derniers mois.
Je repense aux romanciers qui savent décrire l’amour de loin.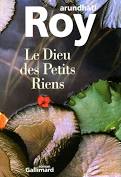
J’ai lu il y a assez longtemps Le Dieu des petits riens de l’écrivaine indienne Arundathi Roy. Comme une adolescente, j’avais été emportée par l’ardente passion du serviteur intouchable Velutha – un intouchable au nom velouté ‒ pour une femme de caste supérieure dont j’ai oublié le nom.
Toute l’intensité passait dans des présences et des silences insolemment respectueux accompagnés de regards brûlants.
Puis, les deux êtres bravaient l’interdit social, se touchaient enfin, et le livre plongeait dans la banalité.
P.S. Au moment de publier ce billet, je m’aperçois qu’une chronique du Monde de ce soir traite du même sujet en prévoyant que cet été “sexualité rimera avec austérité”.
On n’imagine pas qu’un historien puisse être « touchant » au même titre qu’un poète, et c’est pourtant le cas de Michelet qui possède au plus haut point l’art de prendre tendrement les êtres entre ses mains. On le découvre notamment dans les œuvres qu’il consacre à la nature : L’Oiseau, L’insecte, La Mer, La Montagne.
J’ai en mémoire un chapitre de La Mer (1861) concernant un animal dont on redoute habituellement le contact : la méduse au nom terrible et pétrifiant, nom particulièrement mal adapté à cette créature fragile, transparente et sans coquille, dit Michelet qui écarte Méduse pour toucher les méduses.
 En séjour à Hyères, il remarque une méduse déposée par une vague entre des rochers, que le vent a retournée et desséchée :
En séjour à Hyères, il remarque une méduse déposée par une vague entre des rochers, que le vent a retournée et desséchée :
Très froissée en ce pauvre corps, elle était blessée, déchirée en ses fins cheveux qui sont ses organes pour respirer, absorber, et même aimer. Tout cela, sens dessus dessous, recevait d’aplomb le soleil provençal, âpre à son premier réveil, plus âpre par l’aridité du mistral qui s’y mêlait par moments. Double trait qui traversait la transparente créature. Vivant dans ce milieu de mer dont le contact est caressant, elle ne se cuirasse pas d’épiderme résistant, comme nous autres animaux de la terre ; elle reçoit tout à vif (p. 151).
La méduse, un animal sans peau… Craignant davantage pour la mienne, je me contente de tâter parfois d’un orteil timoré les méduses qui parsèment parfois, comme des tutus bleus ou violets, mon rivage normand.
Après avoir avoué « un peu de répugnance » aussitôt surmontée, l’auteur saisit l’animal gélatineux qu’il nomme « délicieuse créature, avec son innocence visible et l’iris de ses douces couleurs » :
Je glissai la main dessous, soulevai avec précaution le corps immobile, d’où tous les cheveux retombèrent, revenant à la position naturelle où ils sont quand elle nage. Telle je la mis dans l’eau voisine (p. 152).
Et il lui sauve la vie.
Je ne connais pas assez bien Michelet pour savoir si son appréhension des faits historiques est aussi délicate que sa saisie de la méduse en détresse. Lui qui s’est comporté de manière si contraire à celle du héros décapiteur Persée revalorisé en 1792, comment a-t-il pu aborder les chapitres sur la Terreur ?
Je crois avoir lu (mais je n’ai pas sous la main La Montagne qui aborde ce sujet), que la rédaction des passages de l’Histoire de la Révolution française concernant 1793 avait ébranlé ses nerfs au point que son médecin lui avait prescrit une cure de bains de boue dans un établissement thermal italien. En bon “touchant », il s’était senti régénéré par ce contact et je me souviens de son exclamation émerveillée « Terra mater ! »
(Une brève recherche sur Internet me confirme cette résurrection par la terre : il s’agit du chapitre de La Montagne intitulé « La Bollente, Acqui. Comment je fus inhumé pour revivre ».)
Au cours de la sombre année 1942, deux poètes publient leur premier vrai recueil : Francis Ponge, Le Parti pris des choses, et Eugène Guillevic, Terraqué. Ils ont en commun de parler, à l’écart de l’univers onirique ou politique surréaliste, des choses quotidiennes et palpables.
J’ai évoqué ici le mois dernier Le Savon de Francis Ponge, matière mousseuse qu’il se plaît à retourner dans ses mains et dans ses mots en un temps de guerre et de pénurie.
Mais Guillevic reste pour moi le plus authentique des « poètes touchants” car Terraqué s’écrit à partir d’une peur profonde que la réalité du monde tangible peut seule conjurer.
 Jean Tortel l’a perçu il y a longtemps (Guillevic, Poètes d’aujourd’hui, Seghers, 1954) : “Toute la poésie de Guillevic est possédée de l’intense besoin de toucher, afin d’éprouver la présence d’une espèce d’épaisseur. » Dans Terraqué cette poésie touche les pierres, les écorces, pourrait même se blottir contre le ventre d’un boeuf écorché, et palper les murs de notre cellule afin qu’ils cessent de se comporter comme des monstres.
Jean Tortel l’a perçu il y a longtemps (Guillevic, Poètes d’aujourd’hui, Seghers, 1954) : “Toute la poésie de Guillevic est possédée de l’intense besoin de toucher, afin d’éprouver la présence d’une espèce d’épaisseur. » Dans Terraqué cette poésie touche les pierres, les écorces, pourrait même se blottir contre le ventre d’un boeuf écorché, et palper les murs de notre cellule afin qu’ils cessent de se comporter comme des monstres.
Nous liquiderons la peur. De la nuit
Nous ferons du jour plus tendre —
Et nous n’aurons besoin
Que du toucher des peaux.
(Terraqué)
Dans le recueil Exécutoire (où l’on entend “exutoire”), ce toucher permet de savoir, ou de croire savoir :
Les mots,
C’est pour savoir.
Quand tu regardes l’arbre et dis le mot : tissu,
Tu crois savoir et toucher même
Ce qui s’y fait (…)
Et la peur
Est presque partie.
(Exécutoire)
La suite de l’œuvre, plus sereine, développe cette recherche du contact immédiat et vital, comme le montrent d’autres vers de Guillevic glanés sur ce blog touche-à-tout, “Car sans toucher / On ne fait rien” (Etier, 1979). http://patte-de-mouette.fr/2016/10/10/un-autre-toucher/ Et aussi : http://patte-de-mouette.fr/2018/04/10/humilite/