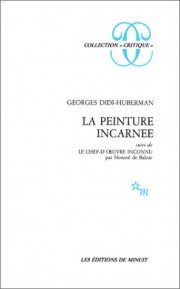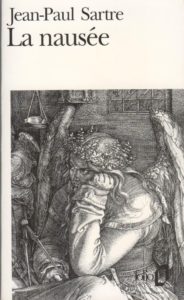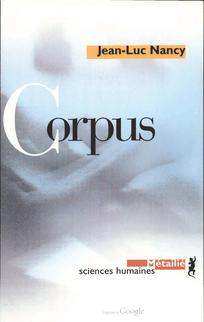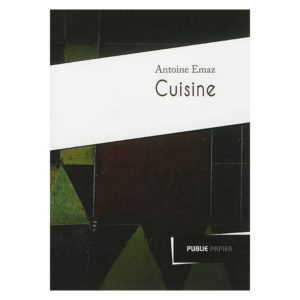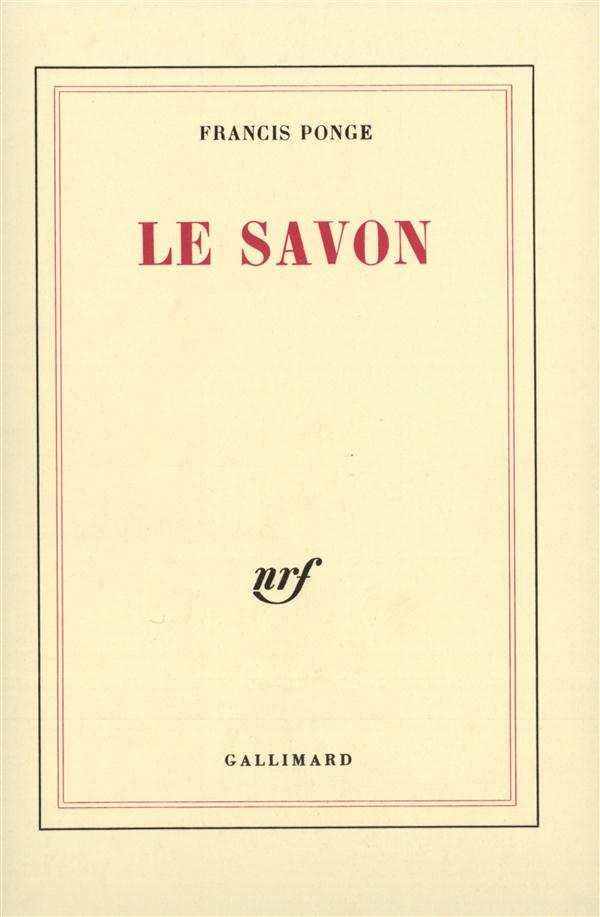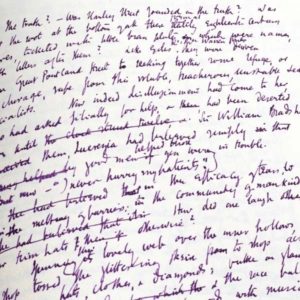Qui aurait cru il y a trois mois que le mot savon nous parlerait autant ? Après avoir vu l’autre jour un document INA sur Le Grand Recueil de Francis Ponge j’ai consulté ma bibliothèque, et c’est du Savon que je me suis emparée presque avidement, espérant qu’il m’aiderait à faire, comme dit l’auteur, la « toilette intellectuelle » dont j’ai besoin.
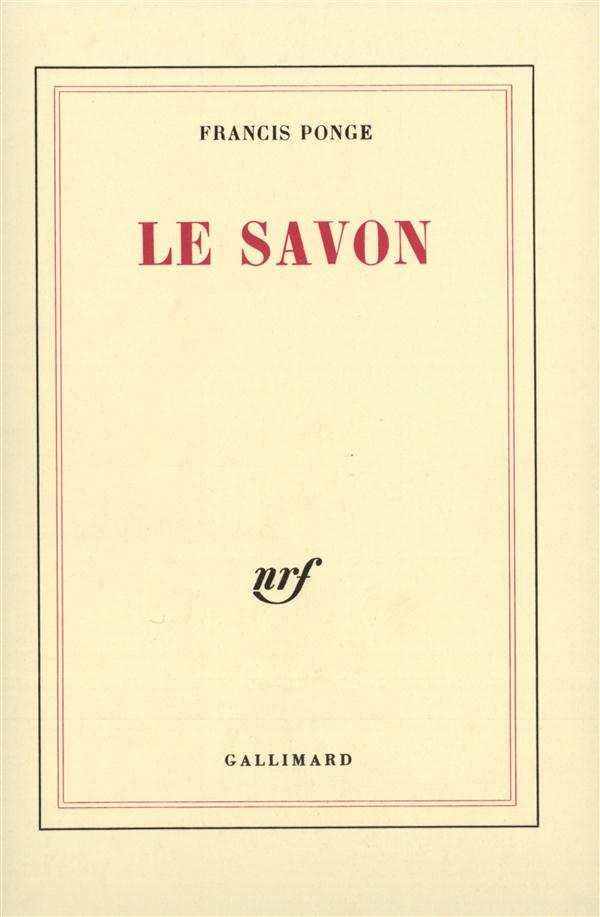
Gallimard, 1967.
Ce livre un peu bizarre qui me serait peut-être tombé (ou glissé) des mains l’an dernier s’est avéré extrêmement stimulant.
Sa rédaction s’étale sur plus de vingt ans, entre avril 1942 et le 3 janvier 1965. Il s’agit d’une série de variations, au sens musical du terme, autour de cet « adorable » produit qui tient du galet, de l’œuf, de la pâte, de la bulle, et d’autres choses encore.
Arrive un homme aux mains sales. Alors le savon oublié va se livrer à lui. Non sans quelque coquetterie. Il s’enrobe de voiles chatoyants, irisés et, en même temps, tend à s’éclipser, à s’enfuir. Point de pierre plus fuyante dans la nature. Mais alors le jeu justement consiste à le maintenir entre les doigts et l’y agacer par l’addition d’une dose d’eau suffisante pour obtenir une bave volumineuse et nacrée, tandis que si on le laissait séjourner dans l’eau, il y mourrait de confusion.
Le savon qui tient aujourd’hui une si grande place dans notre existence est nettement moins sensuel, moins suggestif et moins propice à la rêverie que celui de Ponge. Notre manière de nous frotter les mains est au contraire hypocondriaque et fébrile, en ce curieux moment où on ne peut toucher personne et où se laver les mains au savon est le principal « geste barrière» contre le virus qui nous menace.


Les circonstances de la fabrique du livre de Ponge sont émouvantes. Les toutes premières notes ont été composées à Roanne où le poète et sa famille n’étaient pas exactement confinés mais, « comme on disait alors, repliés — ou réfugiés ». On était en pleine guerre et le savon était une denrée rare. Ponge écrira le 8 août 1946 :
C’est aussi parce que nous étions, “alors”, cruellement, inconcevablement, absurdement privés du savon (comme nous l’étions, dans le même temps, de plusieurs choses essentielles : pain, charbon, pommes de terre), que nous l’avons aimé, apprécié, savouré comme posthumement dans notre mémoire, souhaité de le refaire en poésie…
Nous ne sommes pas aujourd’hui en Europe à court de savon ni privés de pain ou de pommes de terre. Alors pourquoi ce texte résonne-t-il si profondément en moi ? Peut-être parce que Ponge me montre une fois de plus qu’écrire c’est rechercher un objet perdu (« A la Recherche du Savon Perdu », humorise-t-il à la même page). Ecrire c’est aussi pour lui faire mousser jusqu’à sa complète dissolution son objet, en le tournant, le retournant avec des mots polis, glissants, baveux… Puis c’est demander malicieusement : « Avez-vous entendu parler de l’adéquation du fond à la forme ? »
Après avoir reconstitué de toutes les manières possibles devant nous ce banal et chatoyant objet, le poète nous lance un appel irrésistible :
Mais enfin, si je pousse plus loin l’analyse, il s’agit beaucoup moins de propulser moi-même des bulles, que de vous préparer le liquide (ou la solution, comme on dit si bien), de vous tenter d’un mélange à saturation, dans lequel vous pourrez, à mon exemple, vous exercer (et vous satisfaire) indéfiniment, à votre tour…
Se préparer, chacun à son tour, sa propre « solution, comme on dit si bien »… Entendu, on va essayer.
Je m’aperçois que Denis Podalydès vient également de lire Le Savon (revanche inopinée de l’objet humble cher à Francis Ponge).
https://www.franceculture.fr/litterature/denis-podalydes-interprete-le-savon-de-francis-ponge