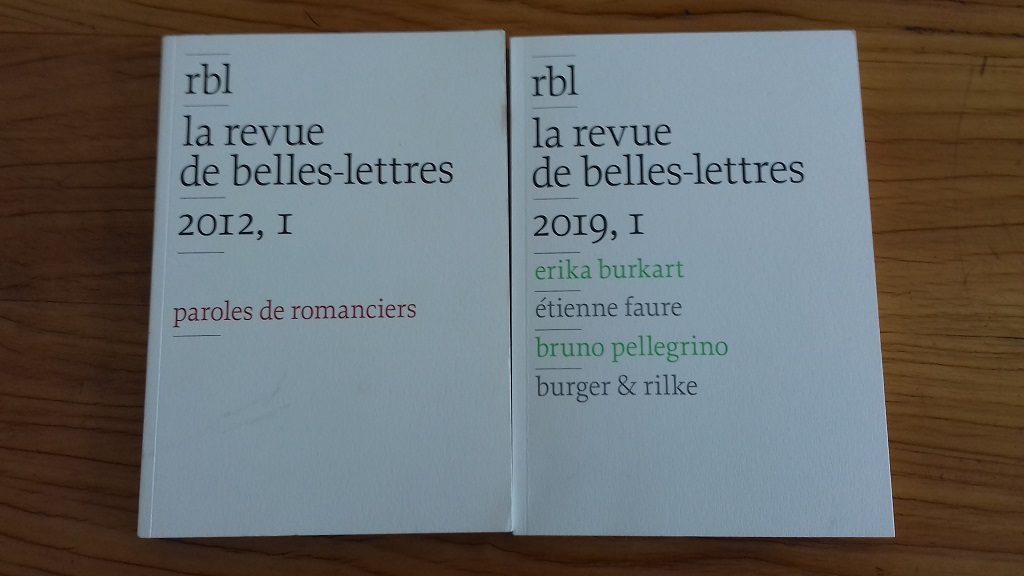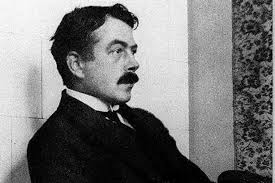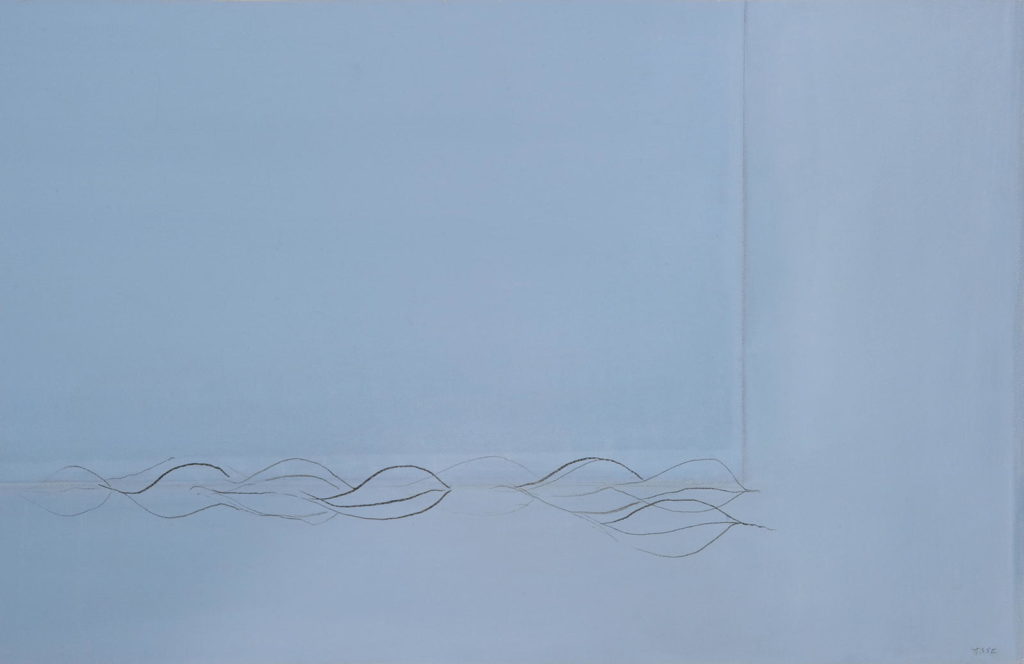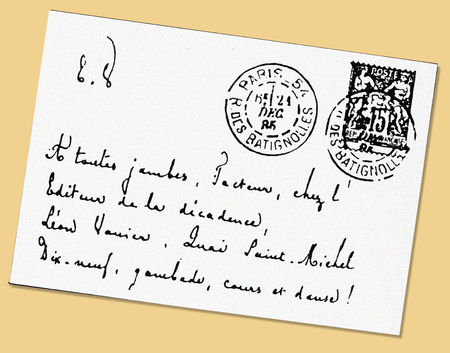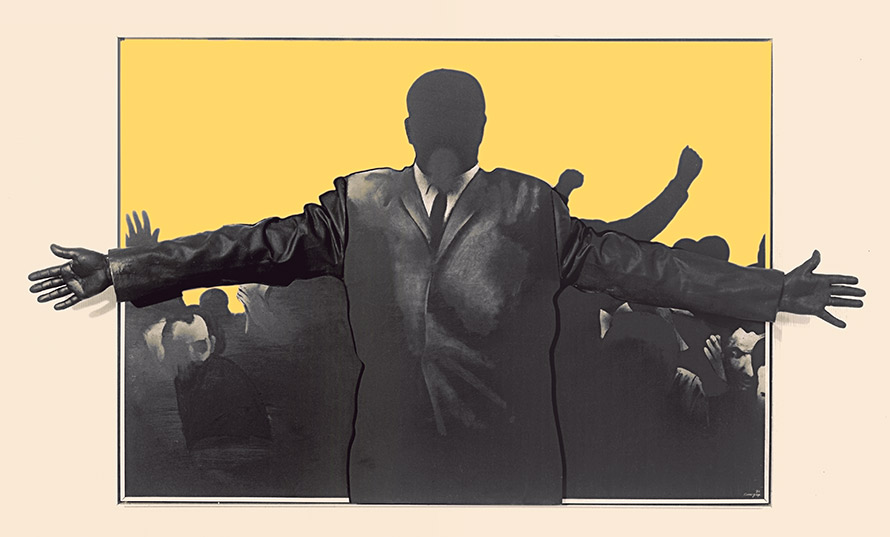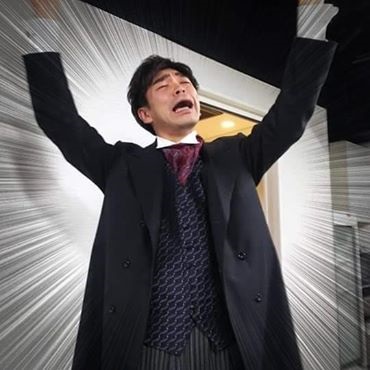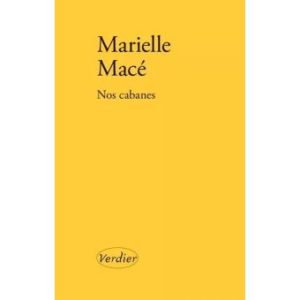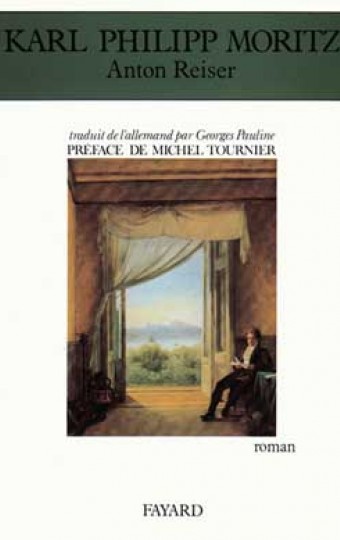Le lendemain de sa rencontre bouleversante avec la vache (voir billet du 24 avril), Gombrowicz assène péremptoirement aux amis qui l’hébergent dans leur estancia :
Un animal n’est pas fait pour porter sur lui un autre animal. Un homme sur un cheval est aussi saugrenu qu’un rat sur un coq, une poule sur un chameau, un singe sur une vache, un chien sur un buffle. L’homme à cheval est un scandale, une perturbation de l’ordre naturel, un artifice plus que choquant, quelque chose de dissonant et de laid (…) Nous regardons depuis des siècles des statues équestres et des hommes à cheval, mais si on se lavait un peu les yeux et qu’on y appliquait un regard neuf, on grimacerait de dégoût, car le dos d’un cheval n’est pas une place pour l’homme, pas plus que celui d’une vache.

Ville de Brême, statue des animaux musiciens
En Argentine, « cette Acropole chevaline » où il réside, Gombrowicz s’amuse à provoquer ses hôtes devant leurs soixante juments « tournant vers nous leurs regards d’une douce tiédeur ». Mais ses propos ont, l’air de rien, une résonance très contemporaine par le décentrement du regard humain qu’ils supposent : “Si on se lavait un peu les yeux et qu’on y appliquait un regard neuf”… Pour un Polonais des années 50 il existait en gros deux regards : le regard chrétien et le regard communiste. Aucun des deux, si on excepte Saint François d’Assise, ne concerne vraiment les animaux. Mais aujourd’hui ?
Marielle Macé aborde ces questions à partir de l’expérience de la ZAD de Notre Dame des Landes, région à laquelle elle est familialement attachée. Elle propose dans Nos Cabanes un nouveau “concernement », un « attachement à l’existence d’autres formes de vie et un désir de s’y relier vraiment », en mettant fin à ce qui nous conduit à nous croire si distincts des animaux et des plantes. Pour « renouer » avec les choses du monde, pour nous faire “être forêt », « être fleuve », et surtout “être oiseau”, la poésie, avec « sa force de vérité écopolitique » est le meilleur point d’appui.
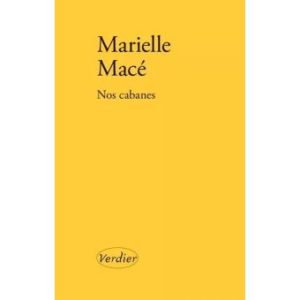 Que penserait Gombrowicz de cela ? Bien qu’il se dise « de la nouvelle école » pour sa sensibilité à la souffrance universelle, je ne peux pas m’empêcher de lui prêter le sourire ironique de l’éternel exilé qui se sait irrémédiablement déchiré, séparé, « antivache », “antinature ». Et il ne lui échapperait pas, non plus qu’à Marielle Macé, que la lutte poético-politique qu’elle mène par ses jeux d’homonymes autour de “noues/nouer/nous” et ses verbes à l’infinitif pleins d’énergie ne pèse pas bien lourd face aux pratiques de la “technosphère”.
Que penserait Gombrowicz de cela ? Bien qu’il se dise « de la nouvelle école » pour sa sensibilité à la souffrance universelle, je ne peux pas m’empêcher de lui prêter le sourire ironique de l’éternel exilé qui se sait irrémédiablement déchiré, séparé, « antivache », “antinature ». Et il ne lui échapperait pas, non plus qu’à Marielle Macé, que la lutte poético-politique qu’elle mène par ses jeux d’homonymes autour de “noues/nouer/nous” et ses verbes à l’infinitif pleins d’énergie ne pèse pas bien lourd face aux pratiques de la “technosphère”.
La semaine dernière j’ai entendu, à l’émission La Grande Table de France Culture, Alessandro Pignocchi, ancien chercheur en sciences cognitives, aujourd’hui zadiste militant à Notre Dame des Landes, qui vient de publier une bande dessinée, La Recomposition des mondes. N’ayant pas trouvé le rapport nature/culture qu’il cherchait auprès des Jivaros d’Amazonie, il a été émerveillé par la découverte de la ZAD. “Ici, il n’y a plus de relation de sujet à objet avec les plantes et les animaux, explique-t-il, mais de sujet à sujet. » Plus d’exploitation, plus de protection au service de l’exploitation, l’arbre devient un « pote » et l’abeille une « collègue ». Peu à peu, les conséquences politiques de cette attitude sont exposées d’un ton affable : « Pas d’issue sans démolir la sphère économique”, « il faut aller à l’affrontement avec l’Etat de toutes les façons possibles… Ce que vous, médias, nommez de façon un peu obscène violence, il faudrait l’appeler légitime défense. »
 Casser l’État pour dialoguer avec une grenouille ? Gombrowicz n’y avait pas songé, mais il n’est pas un romantique. Marielle Macé n’y a pas songé non plus. Peu séduite par cette “légitime défense” zadiste (un jour je ferai une note sur le mot “obscène”), je me suis tournée un moment vers Bruno Latour qui juge l’imaginaire révolutionnaire aussi inadapté que le néolibéralisme à une “politique de la nature ». Mais ma prochaine cabane mentale sera surtout un colloque international intitulé “Le Regard écologique », organisé par Jean-Patrice Courtois et Martin Rueff (euh… des poètes) qui se tiendra les 23 et 24 mai prochains à Paris. J’espère en particulier je ne sais quoi de la communication de Charles Malamoud “Écologie et non-violence dans le rituel de l’Inde védique ». Peut-être y sera-t-il question de vaches ?
Casser l’État pour dialoguer avec une grenouille ? Gombrowicz n’y avait pas songé, mais il n’est pas un romantique. Marielle Macé n’y a pas songé non plus. Peu séduite par cette “légitime défense” zadiste (un jour je ferai une note sur le mot “obscène”), je me suis tournée un moment vers Bruno Latour qui juge l’imaginaire révolutionnaire aussi inadapté que le néolibéralisme à une “politique de la nature ». Mais ma prochaine cabane mentale sera surtout un colloque international intitulé “Le Regard écologique », organisé par Jean-Patrice Courtois et Martin Rueff (euh… des poètes) qui se tiendra les 23 et 24 mai prochains à Paris. J’espère en particulier je ne sais quoi de la communication de Charles Malamoud “Écologie et non-violence dans le rituel de l’Inde védique ». Peut-être y sera-t-il question de vaches ?