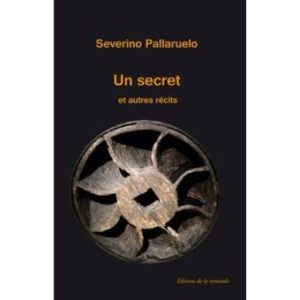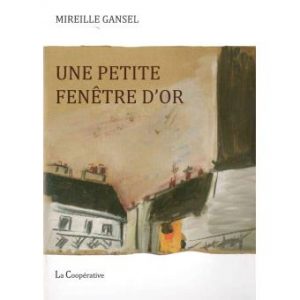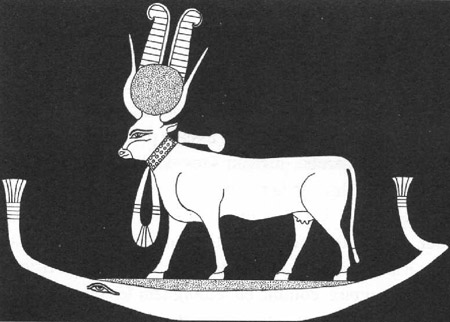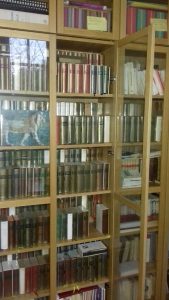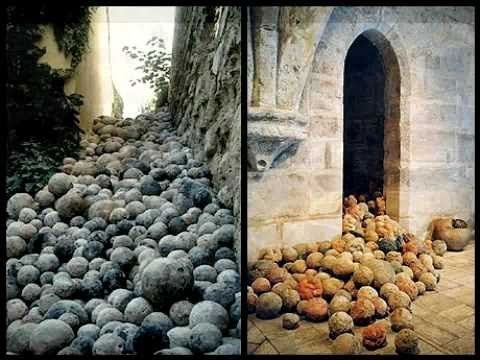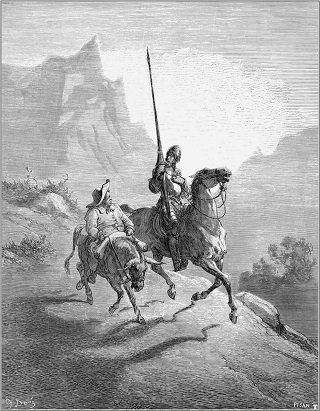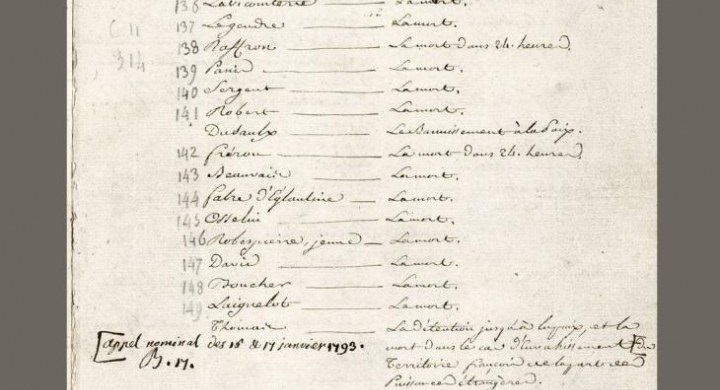Le jeune Toné, personnage d’une nouvelle de Severino Pallaruelo, passe pour un imbécile dans son village, et il y est si méprisé que même quand il obtient l’emploi respectable de camionneur-livreur de yaourts pour un supermarché de Saragosse : « Au village, l’emploi de Toné eut pour conséquence que l’on perdit tout respect envers le yaourt, la circulation à Saragosse et les supermarchés ».
Cette annulation systématique de certains êtres qui contamine tout ce qu’ils font et tout ce qu’ils touchent, leur bouchant à jamais tout horizon, a résonné en moi avec le propos d’un des livres les plus intéressants et les plus méconnus de Nathalie Sarraute : « disent les imbéciles », où l’on voit comment des hiérarchies préétablies empêchent les idées libres et vivantes de se développer. Un de ces êtres anonymes qui surgissent dans le roman se recroqueville et se condamne ainsi d’avance lui-même : « Son petit cerveau d’où les idées sortent toujours désarmées… Son cerveau qui ne peut mettre au monde que des idées mort-nées, nourries de son sang, son lourd sang vicié… »
Me vient maintenant à l’esprit un souvenir qui peut prolonger ce propos : après avoir relu et apprécié l’an dernier Dominique de Fromentin j’ai découvert le jugement qu’en fait Proust en trois mots : « Court et niais ». Ce roman dont j’admire la finesse et la mélancolie devenait une petite chose méprisable, et j’ai eu l’impression que Proust m’envoyait un verre d’eau froide à la figure avec ce « court et niais » qui me jetait en passant, moi qui aimais Fromentin, dans la catégorie des imbéciles, des niais et des Toné.
Lisons les livres de Sarraute, de Pallaruelo et de tous ceux qui aident à soulever ces dalles d’autorité. Supportons aussi que Proust soit quelquefois injuste et mal luné.