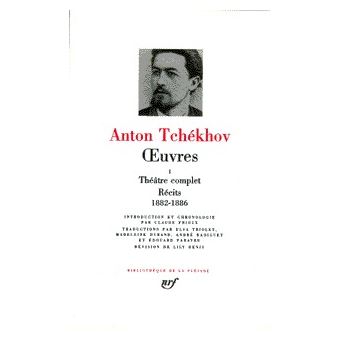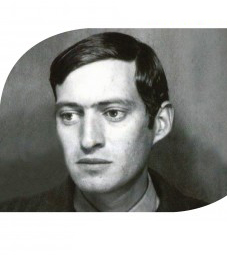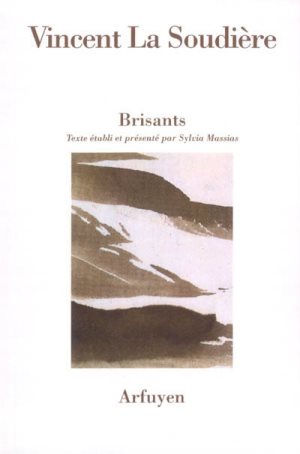à peine ose-t-on
croire à un début
les mains se refroidissent et les châteaux rétrécissent.
« Ô saisons, ô châteaux »…
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Mais « dans les livres souriants, dans les jeux des enfants, je vais ressusciter pour dire que le soleil brille », dit Ossip Mandelstam cité par Sylvie Dallet dans sa préface au livre de Marie-Paule Farina Flaubert, les luxures de plume. Et le Flaubert de ces pages nous ensoleille l’esprit, un Flaubert aussi éloigné de « l’idiot de la famille » décrit par Sartre que du prosateur impeccable et vernissé vanté par la critique du XXème siècle. Marie-Paule Farina, avec une indépendance d’esprit revigorante, dégagée de tout carcan universitaire et de toute bigoterie idéologique, plonge gaillardement dans cette œuvre, notamment la Correspondance éditée par la Pléiade, et en tire des trésors dont très probablement d’ailleurs la recherche flaubertienne bénéficiera.
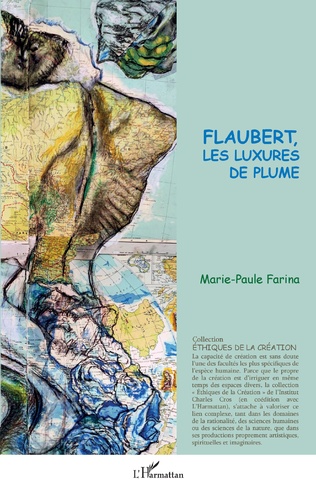 Dans la plupart des livres que je lis, je suis avant tout sensible à cet élément difficile à définir qu’est le ton. Ce qui rend le livre de Marie-Paule Farina si vivifiant, c’est un ton enjoué, affectueux, qui sonne toujours juste car toujours en harmonie avec son sujet. Nous découvrons avec elle « un homme » au lieu d’un « auteur » (selon la distinction qu’opère Pascal dans les Pensées). Un homme grand de taille (je l’imaginais je ne sais pourquoi petit comme Balzac), truculent, généreux, enfantin, excessif, volontairement grossier, et très délicat avec ses proches.
Dans la plupart des livres que je lis, je suis avant tout sensible à cet élément difficile à définir qu’est le ton. Ce qui rend le livre de Marie-Paule Farina si vivifiant, c’est un ton enjoué, affectueux, qui sonne toujours juste car toujours en harmonie avec son sujet. Nous découvrons avec elle « un homme » au lieu d’un « auteur » (selon la distinction qu’opère Pascal dans les Pensées). Un homme grand de taille (je l’imaginais je ne sais pourquoi petit comme Balzac), truculent, généreux, enfantin, excessif, volontairement grossier, et très délicat avec ses proches.
Le critique dont rêve Flaubert, dit Marie-Paule Farina, « ne doit être ni grammairien ni historien, il doit être (…) pourvu d’imagination, d’enthousiasme et d’une grande bonté. »
Elle peut être rassurée : ces trois qualités sont indéniablement celles de son livre.