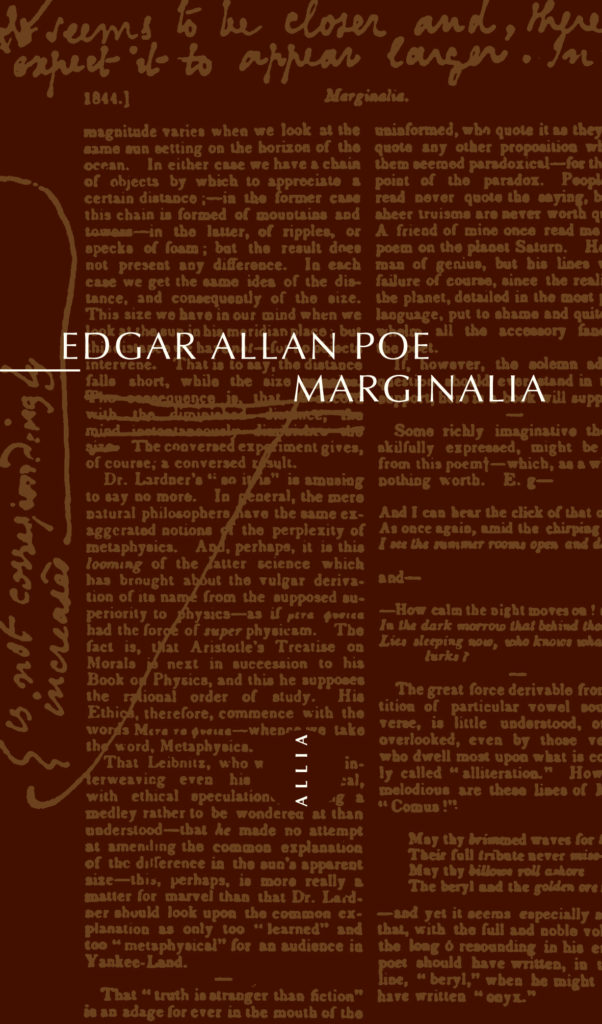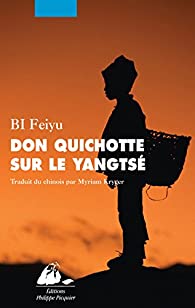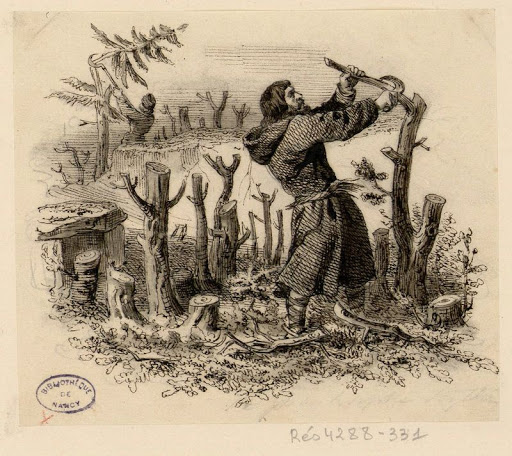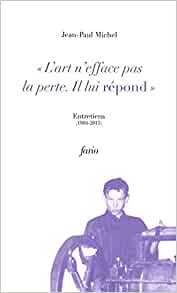Exceptionnellement, ma patte se pose aujourd’hui sur des morceaux d’un article que j’ai publié il y a quelques années dans un magazine, car j’aimerais revenir sur un de mes sujets préférés, à peine effleuré sur ce blog en juillet dernier http://patte-de-mouette.fr/2020/07/24/les-choses-et-les-mots/#comments
A l’occasion d’une réunion sur la scolarisation des élèves étrangers, les inspecteurs et les formateurs du CASNAV (Centre Académique pour la Scolarisation des enfants allophones Nouvellement Arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et de Voyageurs) m’ont appris trois choses essentielles :

Ressources pour l’inclusion des élèves allophones du CASNAV de Metz-Nancy
1. On ne dit plus : intégration des élèves étrangers, mais : inclusion des élèves nouveaux arrivants. Je consulte le dictionnaire : l’intégration est l’opération par laquelle un individu ou un groupe s’incorpore à une collectivité. Elle peut être politique, sociale, raciale. Raciale ! J’ai compris : l’intégration est racialiste. Au contraire, l’inclusion est neutre, mathématique : “propriété d’un ensemble A dont tous les éléments font partie d’un autre ensemble B.” Mais, dit encore le dictionnaire, on parle également d’inclusion quand un objet, une fleur, un insecte, est conservé dans un bloc de matière plastique transparente. Être inclus, c’est en somme être pris dans une masse sans qu’il soit question de s’en dégager.
2. On ne dit plus, comme le sigle le montre, qu’un élève est non francophone (définition négative qui gomme l’existence d’une langue parlée dans les familles), mais qu’il est allophone (étymologiquement “autre voix”), terme qui prend en compte sa ou ses langues d’origine (que l’on se gardera toujours d’appeler dialectes pour être sûr de ne pas se tromper). L’élève a un parler autre, mais la notion d’autre pouvant contenir je ne sais quoi de discriminant, on ajoute : « les élèves dits allophones ». (À peine l’euphémisme créé, on s’en méfie pour dire qu’on ne dit peut-être pas totalement ce qu’on dit). Variante : « Les élèves allophones, si je puis dire ». Quant à ceux qui arrivent en France sans savoir lire ni écrire, ils sont appelés NSA, Non Scolarisés Antérieurement. Est-ce bien correct ? Ce Non initial stigmatise, et le N, le S et le A pourraient être les initiales de Ne Sait pas l’Alphabet. (En écrivant aujourd’hui ceci, j’imagine soudain un préau de cour de récré où un gamin traite un autre de NSA en lui crachant à la figure). Pire : ces lettres sont contenues dans le mot Niais, qui risque de déraper insidieusement vers ceux qui les ont constituées en sigle.
3. On ne dit plus, comme je le signalais l’autre jour, Classe d’accueil pour désigner la véritable famille scolaire où des jeunes de tous les pays du monde, dans des situations souvent critiques, trouvent un soutien conséquent pendant la première année de leur apprentissage du français. On sait qu’après leur séjour dans ce havre bienveillant au cadre pédagogique exigeant, ils sont intégrés (pardon : inclus) peu à peu dans des classes banales (pour éviter de dire normales, ce qui laisserait supposer que les classes ex-dites d’accueil sont constituées d’anormaux). Dorénavant, on appelle ces classes UP2A : Unité Pédagogique d’Élèves Allophones Arrivants. Le terme UP2A, nous dit l’inspecteur, a été choisi car il est « plus inclusif » que le terme classe d’accueil.
Chaque année on charge la barque de nouvelles circonlocutions qui parviendront sous peu à faire couler les meilleurs lieux de transmission de l’institution scolaire française. J’ai dit transmission ? Ce mot n’est-il pas un peu louche ?
Mais je viens d’ouvrir le journal et me demande si ces débats sont encore de mise avant la rentrée scolaire la plus difficile qui ait jamais existé.
* Morteparole est le titre d’un roman de Jean Védrine (Fayard, 2014), qui parle de “la parole morte et technique qu’impose désormais l’institution scolaire”.
 A marée haute : d’abord marcher en long plus qu’en profond. S’habituer au froid, voir si les vagues ne vont pas m’atteindre plus vite que je ne voudrais (c’est presque toujours le cas). Après les jambes, le « divertissoir » comme disait maman (étape selon elle primordiale d’une baignade). C’est là que j’attends le déclic (quand la vague n’a pas décidé à ma place). Après quelques faux départs ponctués de « un… deux… trois… », je plonge et deviens grenouille. Les dix premières brasses sont précipitées, puis le souffle s’apaise et un rythme s’installe.
A marée haute : d’abord marcher en long plus qu’en profond. S’habituer au froid, voir si les vagues ne vont pas m’atteindre plus vite que je ne voudrais (c’est presque toujours le cas). Après les jambes, le « divertissoir » comme disait maman (étape selon elle primordiale d’une baignade). C’est là que j’attends le déclic (quand la vague n’a pas décidé à ma place). Après quelques faux départs ponctués de « un… deux… trois… », je plonge et deviens grenouille. Les dix premières brasses sont précipitées, puis le souffle s’apaise et un rythme s’installe.