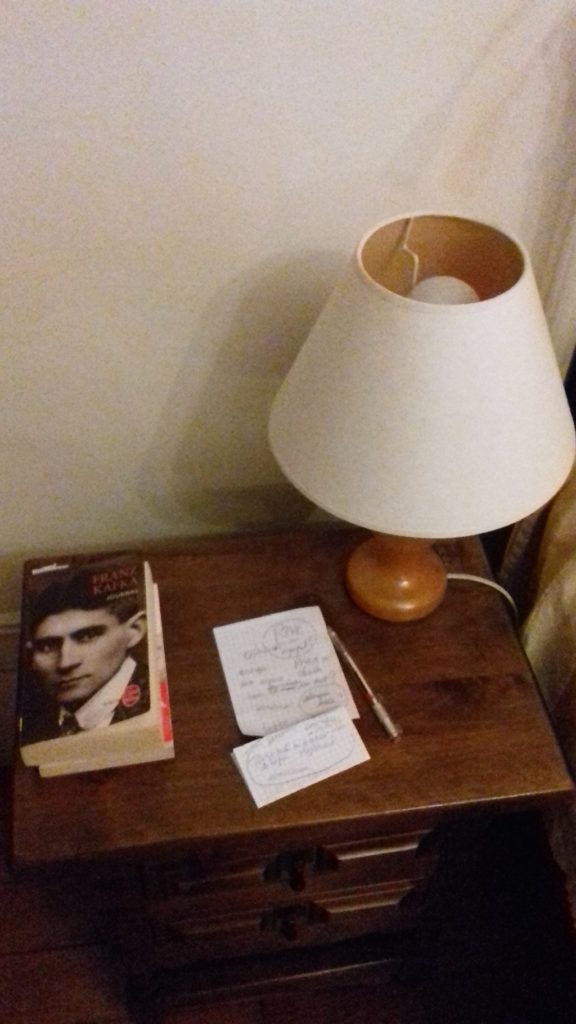On parle aujourd’hui assez facilement de l’humour de quelqu’un mais presque jamais de sa gaieté. Notre époque est vraiment peu folâtre. Je m’afflige que le mot gai soit devenu imprononçable et que presque partout il faille l’épeler pour se faire comprendre : « Je veux dire GAI, g-a-i, pas g-a-y ».
 Sur France Musique, l’autre jour, j’ai entendu un invité souligner la gaieté des Indes galantes de Rameau qui se donnent en ce moment à l’opéra Bastille. Quoi de plus gai, en effet, que la danse des Sauvages ? Cet invité évoquait les propos de Voltaire sur l’opéra, “spectacle aussi bizarre que magnifique (…) où il faut chanter des ariettes dans la destruction d’une ville, et danser autour d’un tombeau ».
Sur France Musique, l’autre jour, j’ai entendu un invité souligner la gaieté des Indes galantes de Rameau qui se donnent en ce moment à l’opéra Bastille. Quoi de plus gai, en effet, que la danse des Sauvages ? Cet invité évoquait les propos de Voltaire sur l’opéra, “spectacle aussi bizarre que magnifique (…) où il faut chanter des ariettes dans la destruction d’une ville, et danser autour d’un tombeau ».
 Ceci me rappelle une lettre de Sade que citait Marie-Paule Farina la semaine dernière : du fond de la Bastille, après dix ans de forteresse, il conseille à une de ses correspondantes d’égayer son style car « les choses les plus monotones peuvent s’écrire gaiement ».
Ceci me rappelle une lettre de Sade que citait Marie-Paule Farina la semaine dernière : du fond de la Bastille, après dix ans de forteresse, il conseille à une de ses correspondantes d’égayer son style car « les choses les plus monotones peuvent s’écrire gaiement ».
Nietzsche, dans Le Gai savoir, raille les philosophes sérieux dont la pensée avance comme une « machine embarrassante, sinistre et grinçante » en se figurant que la bonne humeur fait penser à tort et à travers. « — Tel est le préjugé de cette brute sérieuse à l’égard de tout gai savoir. Eh bien ! montrons que c’est un préjugé ! » (327).
 Mieux vaut quelque ingénue et rustique cornemuse que ces sons mystérieux, ces cris de hibou, ces voix sépulcrales, ces sifflements de marmotte dont vous nous avez régalés jusqu’à présent dans votre désert, monsieur l’ermite, qui mettez l’avenir en musique ! Non ! Assez de ces tons-là ! Entonnons des airs plus agréables et plus joyeux ! (383)
Mieux vaut quelque ingénue et rustique cornemuse que ces sons mystérieux, ces cris de hibou, ces voix sépulcrales, ces sifflements de marmotte dont vous nous avez régalés jusqu’à présent dans votre désert, monsieur l’ermite, qui mettez l’avenir en musique ! Non ! Assez de ces tons-là ! Entonnons des airs plus agréables et plus joyeux ! (383)
Qui nous parlera aussi gaiement de la gaieté ?