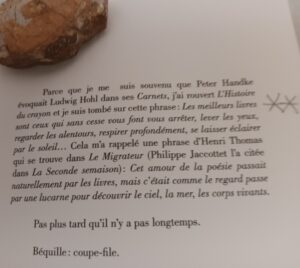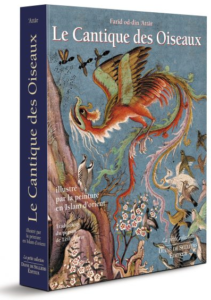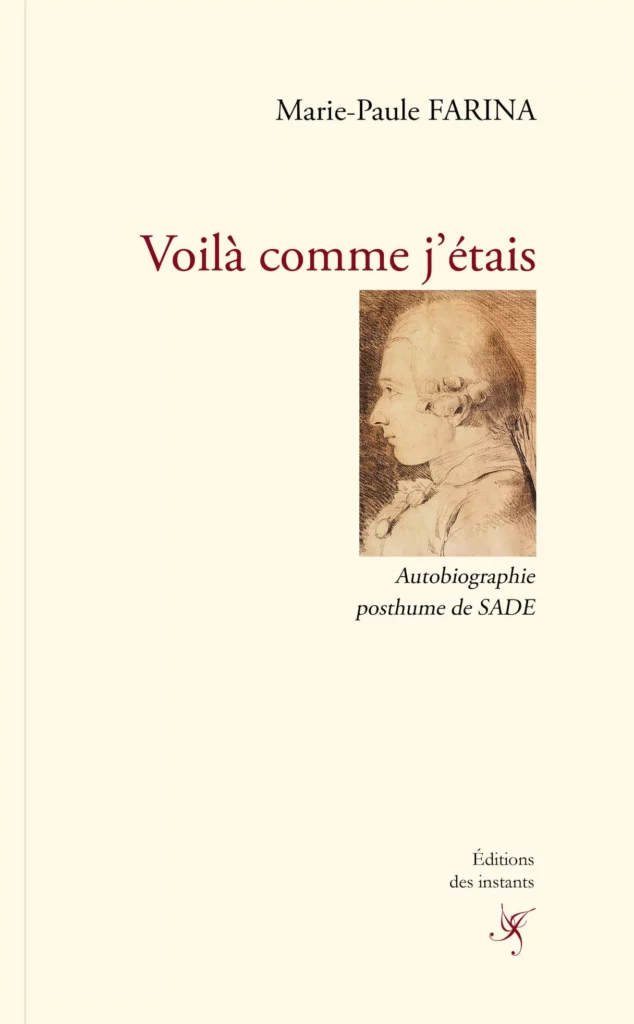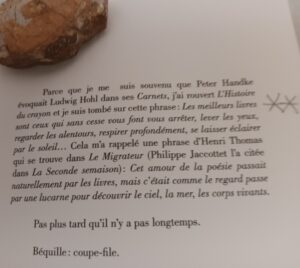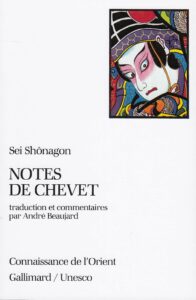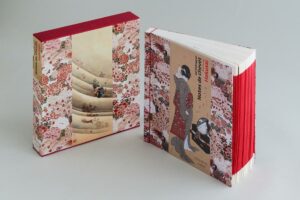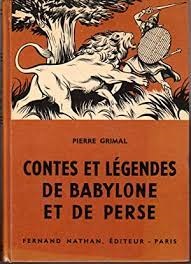M’installer avec un nouveau livre de Jacques Lèbre pour un voyage en train de deux heures, crayon dans la main droite, carnet sous la main gauche : « 121 pages d’un livre de notes bien aéré… J’aurai fini en deux heures », jugeais-je.
« Jujèje»… (parfois des sonorités me distraient de ce que je veux dire, comme une adolescente qui pouffe à un cours). Je jugeais… j’estimais que lecture et trajet coïncideraient, sans tenir compte de deux choses :
– Que dans un voyage en train à l’étage supérieur, côté fenêtre, par matinée ensoleillée d’automne, on est amené à lever le nez.
– Que Jacques Lèbre se lit nez en bas nez en l’air “et dans tous les sens”.
 « Se lit »… j’ai l’air de faire une injonction. Or justement les notes prises par Jacques Lèbre sur dix ans échappent aux injonctions, mélangeant remarques et souvenirs personnels avec des citations d’auteurs aimés.
« Se lit »… j’ai l’air de faire une injonction. Or justement les notes prises par Jacques Lèbre sur dix ans échappent aux injonctions, mélangeant remarques et souvenirs personnels avec des citations d’auteurs aimés.
Par exemple :
Piaillements du matin, plus concentrés, comme un tourbillon toujours à la même place – quelque chose de noué, une boule de piaillements dans la gorge de l’air.
Comment expliquer ce critère de lecture absolument infaillible que je formule ainsi : il faut que je sente quelqu’un derrière ce que je lis.
Ces deux derniers vers d’un poème de Stefan George, traduits par…
Mon train passe trop vite et trop près pour que je puisse lire le nom des gares. Petite frustration.
Le ciel est bleu presque partout. Lèbre parle des nuages qui filent vite, effilochés.
Je pense « buanderie » en me demandant où j’ai lu ce mot récemment, puis je me souviens : c’est chez Christian Bachelin.
Ces mots qui vous traversent… Mes nuages à moi par la fenêtre de ce train n’ont rien d’une buanderie. Nets, légers, angéliques… Un avion trace sa ligne, croise le reflet de la rampe lumineuse du train (pourquoi cet éclairage artificiel en plein jour ?) Les nuages avancent vite aussi, très blancs comme des mantilles, plutôt sortis d’un lavomatic que d’une buanderie.
Les faibles variations d’intensité de la lumière sur la page pendant la lecture, et comment c’est une plus grande clarté qui fait soudain lever les yeux du livre.
… « le ciel étoilé tranquille, vissé d’astres. » (Paul Valéry). C’est bien sûr quand il se fait le plus sensible (et il l’était !) que je suis le plus touché (…) Ces moments où il est finalement assez proche d’un Philippe Jaccottet.
Enfin le train passe plus lentement devant une gare et j’ai le temps de lire « Bueil ». Ce nom a quelque chose de vaporeux. Buanderie ? Par la fenêtre, des lacs avec des cygnes. Jacques Lèbre m’y accompagne :
Les cygnes, comme s’ils avaient encore agrandi le silence. Mais cela n’est pas tout à fait exact. Ce sont eux qui étaient aussi le silence. Grâce à eux, le silence se faisait soudain plus palpable, il devenait soudain visible, délimité dans un corps animal.

Parc Montsouris, cygne noir d’Australie.
Des phrases négatives m’enchantent maintenant dans mon livre, comme cette citation de Tchekhov :
Il n’y a pas besoin de sujet. La vie ne connaît pas de sujet, dans la vie tout est mélangé, le profond et l’insignifiance, le sublime et le ridicule.
Ou cette simple assertion que le poète tire de lui-même :
En matière de poésie : pas d’autorité.
Mon train arrive à Caen à la page 58. A bientôt m’a déjà donné envie de lire ou relire une dizaine d’auteurs et de recopier autant de phrases sur mon cahier de citations.
La deuxième moitié de ma lecture se passe le soir au coin du feu. Je reviens en arrière, repars en avant. Jacques Lèbre entend des oiseaux, croise sur sa route des chevreuils, des biches… parfois mon feu crépite comme des coups de fusil et je sursaute.
Et voici qu’à la page 121 une citation de Peter Handke, ou de Ludwig Hohl par Handke, dans ce long ruban qui ondule entre les esprits, semble être là pour me tenir lieu de conclusion :
Les meilleurs livres sont ceux qui sans cesse vous font vous arrêter, lever les yeux, regarder les alentours, respirer profondément, se laisser éclairer par le soleil…