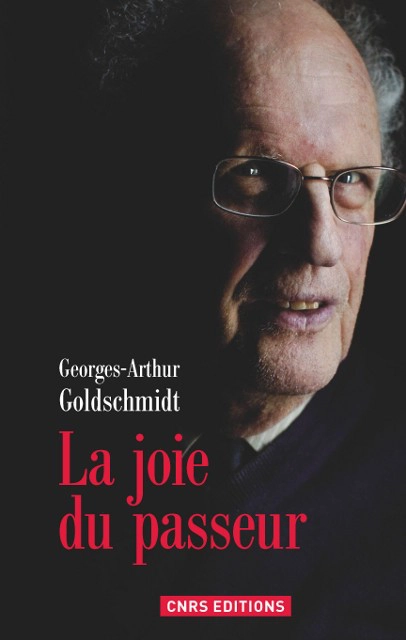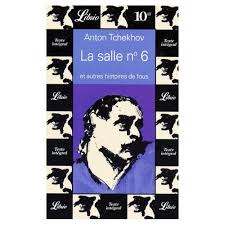Ce texte, plus long que ceux que j’ai l’habitude d’écrire pour ce blog, est la reprise d’une publication que j’avais faite en 2013 sur le site participatif créé par Pierre Rosanvallon, “Raconter la vie”. Le site n’existant plus sur le web, je republie ici ce récit, en écho au livre récent du journaliste d’investigation Victor Castanet sur le groupe d’EHPAD Orpea.
Tous les faits que je narre ici sont absolument authentiques, mon père ayant résidé quelques mois dans une résidence que j’ai nommée “Morphlée”.
Le vieil About ne doit plus rester en institution psychiatrique. Ses enfants cherchent fébrilement des maisons de retraite : « Ici il y a une belle terrasse »,« Ici un parc magnifique », « Ici de la gymnastique douce et un atelier de mémoire », « Là on fête les anniversaires », « Là le directeur a l’air humain », « Mais ici ce n’est pas loin de chez moi», « Oui mais là il y a trois soignants pour quinze résidents… » On ressent presque la même excitation que lorsqu’on espère réussir un examen, louer une villa pour l’été, obtenir une promotion, ou choisir un cercueil simple mais distingué, en merisier comme sa bibliothèque.
Et on tombe sur la Résidence Morphlée, « pour vivre dignement son automne. » Jardin arboré, chambres munies de balcons, salon avec bibliothèque et piano à queue, salle à manger spacieuse, carrelage rutilant. On est comme les jeunes parents qui mettent leur enfant turbulent à la crèche : va-t-il être admis dans ce palace ? Il n’est pas toujours aimable, il peut avoir des gestes brutaux, casser des portes. Mais il aime jardiner et “l’unité protégée pour personnes désorientées et atteintes d’Alzheimer”, au premier étage, se prolonge par une grande terrasse où prochainement va s’organiser un atelier jardinage, nous assure Emmanuelle, une jeune femme qui prononce fortement les e en finale et qui remplit la fonction de « qualiticienne ».
 Les premières heures sont rassurantes. Le médecin coordinateur est là, le médecin traitant va venir demain, tout le personnel semble veiller au bien-être de Monsieur About dont le nom figure sur la porte de sa chambre, une des plus grandes, qui donne sur la terrasse. Il pourra installer le long de sa fenêtre les plantes qu’on va lui acheter.
Les premières heures sont rassurantes. Le médecin coordinateur est là, le médecin traitant va venir demain, tout le personnel semble veiller au bien-être de Monsieur About dont le nom figure sur la porte de sa chambre, une des plus grandes, qui donne sur la terrasse. Il pourra installer le long de sa fenêtre les plantes qu’on va lui acheter.
Mais peu à peu on s’aperçoit que les soignants changent beaucoup, que le Directeur est invisible, que les bleus et les gnons du vieil About sont inexpliqués, que l’atelier jardinage n’a pas commencé, que la grande terrasse est toujours fermée à clé, que les « personnes désorientées et atteintes d’Alzheimer » sont confinées dans un espace commun devant une télé muette constamment allumée au son de vieilles chansons françaises en boucle sur un
lecteur de CD. Et en ce début d’été caniculaire, on ne voit pas souvent de verres d’eau devant les résidents.
Sur le perron, les enfants des résidents de Morphlée murmurent et s’organisent en vue du Conseil de la Vie Sociale (CVS) du 7 juillet 2011. Tous les résidents et leurs familles sont conviés. Madame Colin, représentante élue des familles, circule de groupe en groupe pour dresser la liste des doléances.
Les personnes qui siègent au Conseil de la Vie Sociale sont, en l’absence du Directeur de Morphlée : le Directeur de division Morphlée de la région Ile de France, porteur de mocassins à glands ; la Directrice départementale, blonde ; le médecin coordonnateur régional au sourire irrésistible ; Madame Jade, la future Directrice de la Résidence, blonde, ressemblant à la Directrice départementale ; Emmanuelle, la qualiticienne ; Madame Colin, déléguée des enfants de Morphlée, représentante élue des familles, cahier de doléances en mains ;l’ensemble des résidents (de 70 à 100 ans) et de leurs enfants (de 40 à 70 ans). Dans le salon, des chaises ont été installées et le piano à queue repoussé pour laisser de la place aux fauteuils roulants. Au fond, on aperçoit une table avec champagne et petits fours.
Le Directeur régional prend le micro : « Bonsoir, permettez-moi de nous présenter. Je suis Christophe Toubon, Directeur de division régional… » Il ne parle pas longtemps, interrompu par les résidents et enfants de résidents :
« Où Oùhou ! Et où est notre Directeur de résidence ? Où se cache notre Directeur ? Il a peur de nous ? Hououou ! Il a de quoi ! Houoù ! » Les résidents se lèvent et brandissent leurs cannes dans un brouhaha croissant.
M. Toubon tente de calmer le jeu : « Justement, je viens vous présenter votre future Dir…» Il est interrompu par une résidente à la voix forte : « Et où il est, le Directeur, et qui c’est ces gens ? » Sa fille lui met la main sur le bras et lui dit, fort, à l’oreille : « Attends, maman, il va nous le dire. » Monsieur Toubon essaie de reprendre : « Votre future Directrice, Mme Jade, qui prendra ses fonctions le 1er septembre. » « Et en attendant ? On va rester deux mois sans direction ? Nos parents tout seuls pendant l’été ? Déshydratations ? Coups de chaud ? Fausses routes ? » « Qu’est-ce qu’ils disent ? » demande la résidente à la voix forte en tournant le cou de tous les côtés.
« Où tu as mis tes écouteurs, maman ? Tu les as encore perdus ? »
La directrice départementale s’avance courageusement : « Je suis Mme Scarpetti, Directrice départementale. La gestionnaire et la qualiticienne me tiendront informée, et en attendant que Mme Jade prenne ses fonctions, je viendrai deux fois par semaine. » Une résidente en fauteuil roulant crie :
« Poussez-vous, je ne vois rien, laissez-moi la place ! »
Madame Colin, déléguée des enfants de Morphlée, représentante élue des familles, parvient à prendre le micro : « Nous allons vous faire part des dysfonctionnements de cette maison, et vous nous direz si une Directrice peut se permettre de ne venir que deux fois par semaine. » « Oui, oui ! » La fille de la résidente à la voix forte dit à sa mère : « L’autre jour, on les a retrouvés dans la chambre de Mme Malevoire, tes écouteurs ! Pourquoi tu les enlèves tout le temps ? » « C’est pas moi, c’est une des négresses de la toilette qui me les enlève ! »
Madame Colin poursuit dans le micro : « Voici ce qui m’a été communiqué par les résidents et leurs familles :
1. Il arrive fréquemment que des résidents alités n’aient pas leur dîner servi, par oubli.
2. Il arrive tout aussi fréquemment que le chariot de médicaments ne passe pas le matin ou le soir, ce qui est particulièrement dangereux pour les personnes atteintes d’hypertension, de diabète, ou nécessitant des anticoagulants.
3. La mère de Mme Rosa a fait une chute nocturne, et elle n’a été relevée que le lendemain matin. Par malheur, Mme Rosa mère a une excellente mémoire et se souvient d’avoir attendu et appelé sans réponse pendant plusieurs heures. Que font les gardes de nuit ? Combien de gardes de nuit faut-il ? » « Un pour deux étages à peu près dans les unités ordinaires. Dans une unité protégée, il en faut réglementairement un pour l’étage », dit le médecin coordonateur régional.
« Je peux vous dire que ce n’est pas le cas à Morphlée. Madame Duval veillait l’autre jour son père décédé dans l’après-midi et attendait le médecin pour l’avis de décès. Elle n’a vu passer jusqu’à 23 heures aucun gardien de nuit. J’ai demandé l’autre jour à voir les plannings des gardes de nuit. On m’a répondu que c’était confidentiel. Il va falloir être plus transparent sur des questions aussi importantes. Mais attendez, ma liste n’est pas terminée :
4. Les résidents de l’unité protégée au 1er étage devraient disposer d’une grande terrasse vantée par les prospectus de la résidence. Or, la porte en est constamment fermée à clé, la terrasse envahie de crottes de pigeons, et les résidents atteints d’Alzheimer confinés dans un espace commun rétréci ou dans les couloirs où ils déambulent et s’énervent. Il devait y avoir un atelier jardinage, qu’est devenu ce projet ?
Emmanuelle la qualiticienne prend le micro :
« Cela n’a pas été possiblee car il est à craindreee que les résidents mangent les planteees et que cela provoque des troubles gastriques et intestinaux. »
« Faites-leur cultiver des tomates ! Je continue la liste : 5. Monsieur About… »
La résidente en fauteuil roulant s’agite : « Pourquoi elle me bouche la vue, celle-là ? J’ai dit que je voulais voir. » « Chut ! » fait la personne à côté d’elle, qui est la fille du vieil About.
« 5. Monsieur About, de l’unité protégée, a été trouvé un matin vers 11h par sa fille dans son lit dont les draps étaient souillés de vomi. Il n’était pas habillé ni rasé, sa protection nocturne était souillée aussi. La résidence avait appelé la fille parce que M. About, en grand état de faiblesse, devait être hospita… La résidente en fauteuil roulant hurle d’une voix suraiguë : « Quoi, chut ? Quel culot alors ! Vous allez quand même pas m’empêcher de parler ! « La résidente à la voix forte crie à sa fille : « Tu as vu celle-là qui hurle dans son fauteuil ? Je suis moins délabrée que ça, hein ? » Madame Colin doit hausser le ton pour se faire entendre : « M. About devait être hospitalisé sans diagnostic préalable, parce que le médecin coordonateur était en congé et le médecin traitant injoignable, comme toujours. La fille de M. About a demandé à boire pour son père : le personnel de Morphlée a refusé sous prétexte qu’on ne savait pas ce qu’il avait. » Un homme en fauteuil frappe le bras du fauteuil de la résidente en fauteuil. Elle le griffe. On les évacue. Hurlements dans le couloir.
Madame Colin poursuit dans le micro : « M. About a été emmené aux urgences de l’hôpital C. où il est resté sans soins dans un brancard pendant sept heures. Il mourait de soif et pleurait en essayant de se lever. Au total il souffrait principalement de deshydrat… » Monsieur Toubon, Directeur régional, tend la main vers le micro :
« Je comprends, mais on ne peut pas entrer dans tous les cas particuliers… »
« On est tous des cas particuliers ! C’est pareil pour tout le monde ! » s’égosillent les résidents et enfants de Morphlée.
Madame Colin reprend le contrôle : « Même le Christ sur la croix a eu le droit de boire. Que font les urgences ? » « Le service de gériatrie de l’hôpital C. est remarquable, mais ils sont débordés », soupire le médecin coordonateur régional.
« Alors pourquoi emmène-t-on systématiquement les gens aux urgences, notamment le vendredi, quand il suffit d’un verre d’eau pour les guérir ou du moins les soulager ? Je vais vous le dire, moi : parce qu’on a peur de les soigner sur place, on a peur qu’ils meurent pendant le weekend et que les familles fassent des procès. Parce que les médecins coordinateurs se succèdent, que les infirmiers changent toutes les semaines, qu’ils ne connaissent pas les dossiers, ne savent pas soigner au cas par cas… » Les enfants des résidents se remettent à crier en brouhaha :
« Une honte ! Turn over du personnel soignant ! Pas de fiche de transmission entre les aides-soignants ! Pas de suivi ! Opacité totale ! A l’abandon nos parents ! Pour 4000 € par mois ! 4500 € vous voulez dire ! Sans compter le service de blanchisserie et les consultations des médecins ! 16 résidents en unité protégée, ça fait 72 000 euros par mois dans les poches de Morphlée !
Signalement de maltraitance à la DDASS ! Au Procureur !
 Madame Colin a passé le micro à une fille de résidente qui parle avec modestie : « Désolée d’évoquer encore un cas particulier mais mon témoignage peut concerner tout le monde : en arrivant hier matin pour visiter ma mère de 97 ans, j’ai été étonnée d’entendre qu’elle geignait. Un aide soignant, que j’ai eu peine à trouver, m’a dit qu’elle avait une petite écorchure au coude, due à une glissade lors d’un change de protection. Or, elle se plaignait de vives douleurs à la hanche droite. A 16h30, soit 7 heures plus tard, j’ai obtenu qu’on lui fasse une radio. Fracture du bassin. Aujourd’hui, lorsque ma mère est revenue du service des urgences, les aides-soignants n’étaient informés de rien, ils ne savaient pas qu’ils devaient manier ma mère avec précaution lors des changes.
Madame Colin a passé le micro à une fille de résidente qui parle avec modestie : « Désolée d’évoquer encore un cas particulier mais mon témoignage peut concerner tout le monde : en arrivant hier matin pour visiter ma mère de 97 ans, j’ai été étonnée d’entendre qu’elle geignait. Un aide soignant, que j’ai eu peine à trouver, m’a dit qu’elle avait une petite écorchure au coude, due à une glissade lors d’un change de protection. Or, elle se plaignait de vives douleurs à la hanche droite. A 16h30, soit 7 heures plus tard, j’ai obtenu qu’on lui fasse une radio. Fracture du bassin. Aujourd’hui, lorsque ma mère est revenue du service des urgences, les aides-soignants n’étaient informés de rien, ils ne savaient pas qu’ils devaient manier ma mère avec précaution lors des changes.
J’étais là et j’ai pu le leur dire, mais que se passera-t-il avec l’équipe de nuit ?
Emmanuelle la qualiticienne, dit : « Je prends acte de vos plainteees. Vous avez un cahier à l’accueil que vous pouvez remplireee… » « Et les pages compromettantes sont arrachées ! Toutes ces bourdes, ça fait sale pour les visiteurs ! » crient des enfants de résidents.
Mme Jade dit : « C’est justement ça qui va changer avec la nouvelle direction, j’entends vos dolé… » Un résident crie : « Ça fait cinq ans que je suis là, et 5 ans qu’on me dit que ça va changer avec un nouveau directeur ! J’en ai connu trois ! » La fille de résidente reprend au micro : « Permettez-moi d’insister. Je comprends mal comment il se fait, alors que je passe 5 heures par jour dans votre établissement, que je n’aie pas été avisée de la chute de ma mère et que j’aie dû la deviner moi-même. Ma mère souffre énormément du bassin. Je vous rappelle qu’elle a 97 ans et que la douleur fatigue. Cette dissimulation involontaire, j’en suis sûre, de faits qui ont dû paraître bénins à votre équipe me plonge dans une grande suspicion. Comment se fait-il qu’un change au lit puisse provoquer une chute ? Que devrons-nous penser à l’avenir quand nous verrons une égratignure sur le corps de nos parents ? Jusqu’à présent, malgré tous les dysfonctionnements qui ont été évoqués, j’avais encore un minimum de confiance. Mais à présent ? Je sais que les personnes âgées tombent facilement et qu’on ne peut pas prévenir toutes les chutes, qui laissent parfois des marques spectaculaires. Je sais aussi qu’aujourd’hui vous devez prendre en charge la suite d’au moins une année de gestion calamiteuse. Néanmoins, je me permets d’être la voix de personnes trop âgées, trop fragiles pour s’exprimer elles-mêmes. »
Et Monsieur Toubon, qui consultait discrètement pendant ce discours son téléphone, achève avec un sourire franc, le regard clair : « Nous ferons tout pour rétablir la situation, c’est même pour cela que nous sommes venus. Mais sachons écouter aussi les signes d’impatience de nos résidents qui s’approchent des petits fours… Je vous invite à déguster la collation offerte par Morphlée et je continuerai à répondre individuellement à vos questions devant le buffet. »

 Voici par exemple la pénétration avec laquelle il décrit Maurice, le maquereau surnommé Bubu :
Voici par exemple la pénétration avec laquelle il décrit Maurice, le maquereau surnommé Bubu : Charles-Louis Philippe, après avoir écrit dans la Revue Blanche, a collaboré à la NRF dès le premier numéro. André Gide, dans son Journal de 1909, consacre une dizaine de pages à la mort prématurée de cet ami qu’il tenait en grande estime. Il dit notamment qu’un certain nombre de contemporains, appréciant sa modestie et les qualités « exquises » de son cœur, ont sous-évalué son talent :
Charles-Louis Philippe, après avoir écrit dans la Revue Blanche, a collaboré à la NRF dès le premier numéro. André Gide, dans son Journal de 1909, consacre une dizaine de pages à la mort prématurée de cet ami qu’il tenait en grande estime. Il dit notamment qu’un certain nombre de contemporains, appréciant sa modestie et les qualités « exquises » de son cœur, ont sous-évalué son talent :