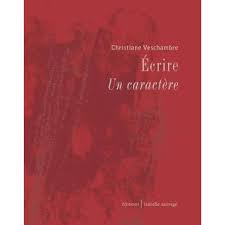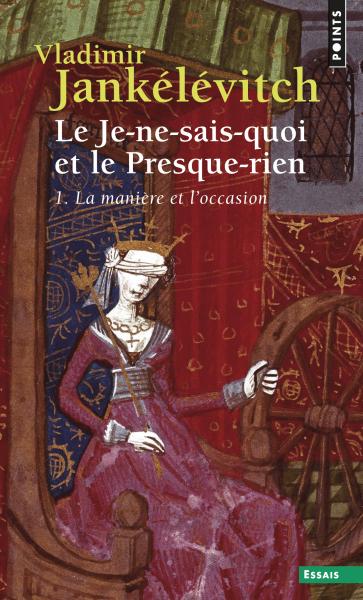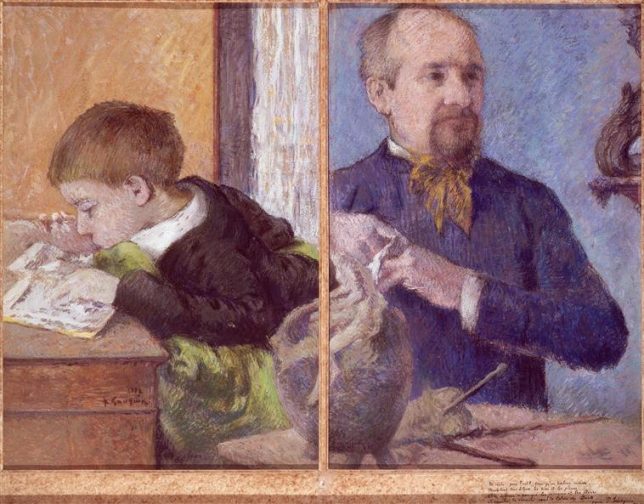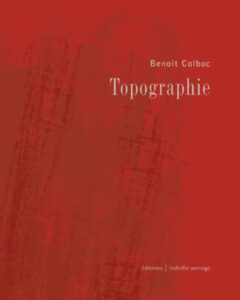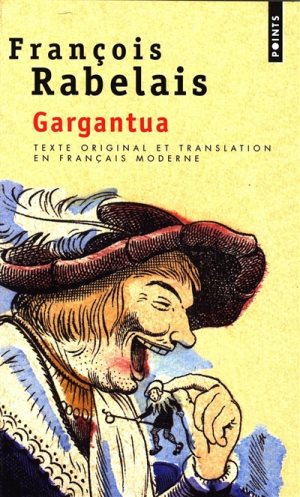Cherchant, dans mes maraudes littéraires, ce qu’un poème peut dire et faire, je tombe sur Isabelle Alentour dont l’amie Frédérique, « L’Hirondelle », aura « quinze ans pour toujours ».
J’hésite à employer l’expression « livre de deuil », tant ce recueil, composé trente-cinq ans après le choc « pour enfin inscrire ce qui n’avait jamais cessé de ne pas s’écrire », progresse en souplesse, par vaguelettes, « sans rien forcer d’ailes et de voiles », et reproduit un bouleversement que les mots ordinaires sont « à jamais trop petits » pour dire.
Le premier vers marque une chute brutale et comme suspendue :
Qui tombe ce matin dans l’ombre du matin
Ce « qui » énigmatique est il relatif à un antécédent indicible, ou une interrogation qui ne trouve pas son point ?
Dans sa syntaxe, sa prosodie et sa typographie, le poème s’approche ainsi de l’abîme de manière lacunaire et progressive, en vers ou en prose, en italique ou en romain*, naviguant entre le passé-présent (ou sans verbe) des faits, et le présent de l’écriture. L’absente est désignée par un « elle » solitaire face au « nous » d’un groupe de filles apparemment insouciantes, dont se détache parfois un « je » qui sent que « derrière le masque » affleure « le tremblement ». Toute la fragilité de l’adolescence :
« Alors la Peur, la Grande Peur. Celle qui ôte le souffle, la fraîcheur du rire, celle qui oppresse, submerge, défait. La Grande Peur brutale, sauvage, totale. »
Chacune se sent renvoyée, solitaire, à sa propre chute :
« L’une a enjambé / l’autre a sauté / une autre encore implore / ou pleure d’insouciance.
C’est la même.
Chacune de nous aurait pu être hirondelle, nous voltigions si haut, hors d’atteinte. Chacune aurait pu s’envoler, se retourner, se jeter, qui sait ? »

La menace est bel et bien là, mais la chute de l’hirondelle déclenche ailleurs chez celle qui reste un mouvement vers le haut, élévation cosmique et fusion presque mystique :
Parfois je me mets à genoux
je me penche en arrière
comme un levier
je regarde dans les étoiles
(plus loin
même
que les étoiles)
je l’appelle
et je fuse
Si bien que le poème se clôt en douceur par un court dialogue entre les deux filles que l’écriture peut enfin rapprocher :
– Je mourrais si je ne tiens pas ta main
– La douceur
de ta main je l’éprouve
me répond l’Hirondelle
je ne l’ai jamais lâchée
Ce que fait ici le poème ? Il donne une main à l’amie envolée et aux adolescents que nous avons tous été.
« (…) C’est bien là, à hauteur de cœur, dans le vide creusé en soi par l’absente qu’insensiblement recommencera à battre la mesure du temps. L’attention aux vivants. »
Pour se procurer ce livre poignant : https://www.editions-aildesours.com/
* Je reproduis tel quel l’italique et réserve les guillemets au romain.