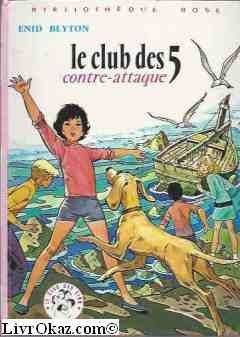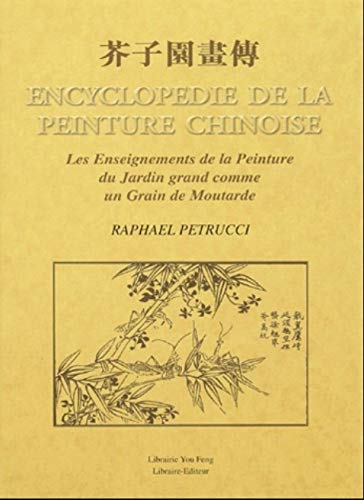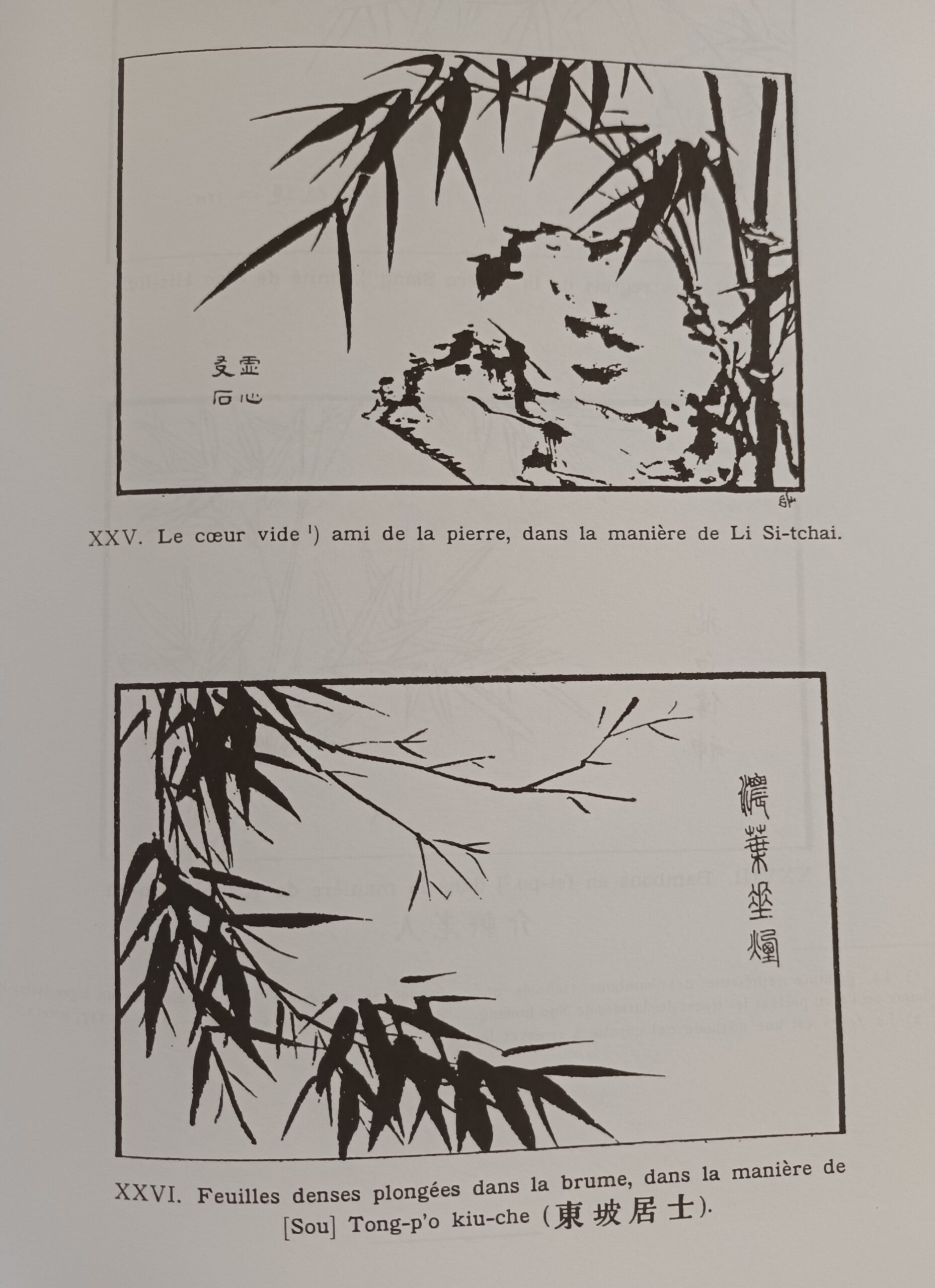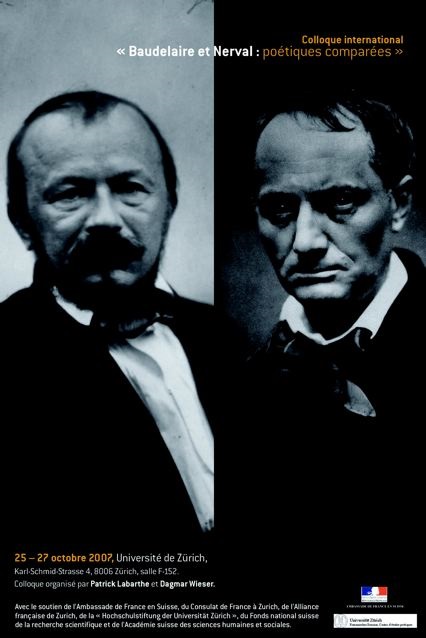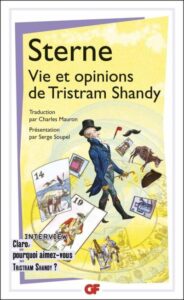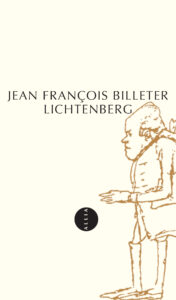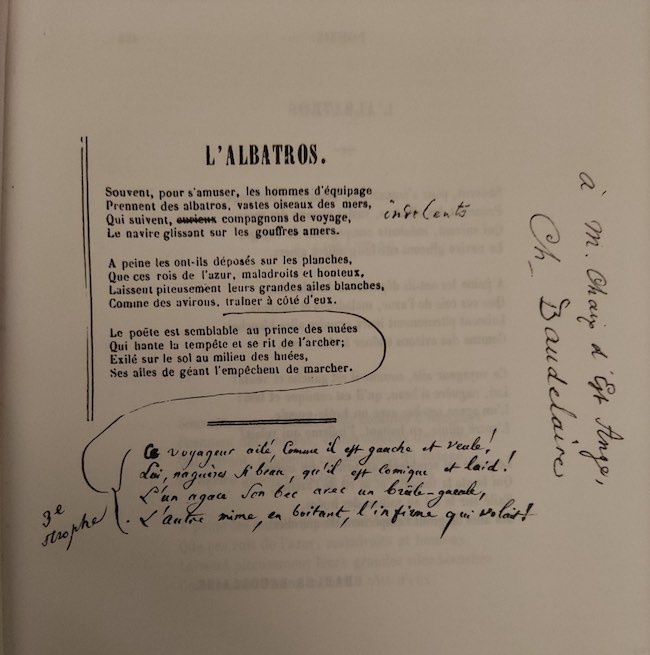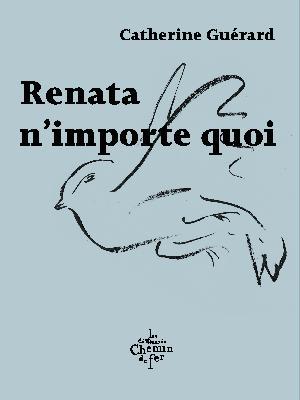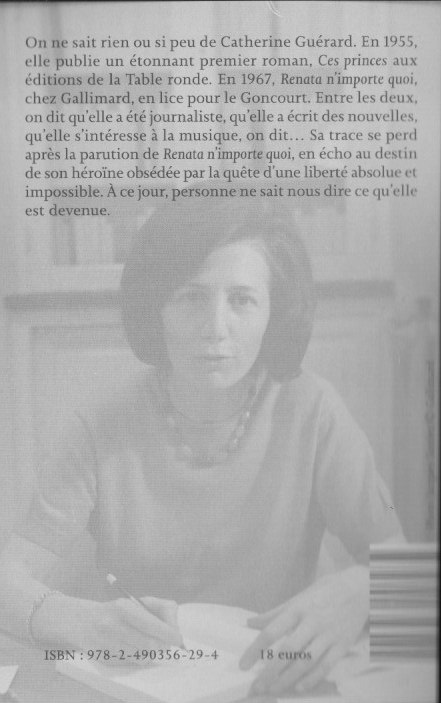« A la place de qui écrit-on ? » me demandais-je l’année dernière à l’aide de Gérard Macé, en évoquant ici les muses muettes – ces mères ou grand-mères de nos vieilles photos – qui sont parfois, « avec leur façon jalouse de garder un secret », à la racine mystérieuse de l’écriture. (Voir lien en fin de billet).
Le hasard de mes relectures m’a fait tomber la semaine dernière à deux reprises sur un autre type de muette : la sœur aînée morte avant la naissance de l’auteur. C’est le cas du psychanalyste Didier Anzieu et de la romancière Annie Ernaux, tous deux ayant été ensuite des enfants uniques.
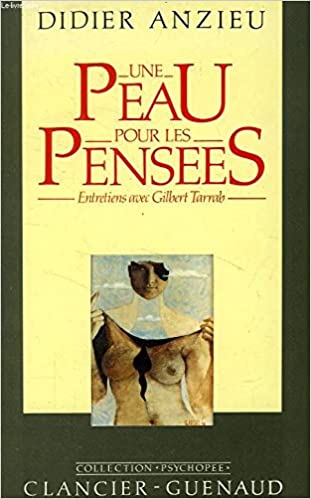 La sœur de Didier Anzieu est morte-née :
La sœur de Didier Anzieu est morte-née :
Cette sœur disparue, qui avait signé leur premier échec, est restée longtemps présente dans les pensées et les paroles de mes parents. J’étais le second, qu’il fallait d’autant plus surveiller et soigner, pour le mettre à l’abri du destin malheureux qui avait frappé l’aînée. (…) La moindre indigestion, le plus petit courant d’air me menaçaient. (…) J’avais à remplacer une morte. Or, on ne me laissait pas vivre suffisamment.
L’enfant est emmitouflé dans de multiples épaisseurs de vêtements, de soins et de soucis :
Ma vitalité se cachait au cœur d’un oignon, sous plusieurs pelures. (…) C’est à cinquante ans que j’en ai pris pleinement conscience. J’ai alors inventé la notion d’enveloppes psychiques et j’ai publié – c’était en 1974 – mon premier article sur le Moi-peau.
 La sœur d’Annie Ernaux est décédée à l’âge de six ans d’une diphtérie, deux ans avant la naissance de l’autrice qui n’a appris son existence et sa mort qu’à l’âge de dix ans, en surprenant une conversation de sa mère avec une voisine. Le elle désigne dans tout le livre la mère, et le tu la soeur, comme dans une lettre écrite à la disparue (le format du livre reproduit d’ailleurs celui d’une enveloppe tamponnée) :
La sœur d’Annie Ernaux est décédée à l’âge de six ans d’une diphtérie, deux ans avant la naissance de l’autrice qui n’a appris son existence et sa mort qu’à l’âge de dix ans, en surprenant une conversation de sa mère avec une voisine. Le elle désigne dans tout le livre la mère, et le tu la soeur, comme dans une lettre écrite à la disparue (le format du livre reproduit d’ailleurs celui d’une enveloppe tamponnée) :
(…) Elle décrit les peaux dans la gorge, l’étouffement. Elle dit : « elle est morte comme une petite sainte. » (…)
elle dit de moi « elle ne sait rien, on n’a pas voulu l’attrister »
A la fin, elle dit de toi « elle était plus gentille que celle-là »
Celle-là, c’est moi.
La situation ressemble à celle d’un conte. « L’autre fille » du titre, est-ce la morte, ou bien « celle-là », la seconde, la moins gentille ?
Ce petit livre de 78 pages est un bijou littéraire si simple et si élaboré à la fois que je vais en faire l’objet d’un prochain billet.
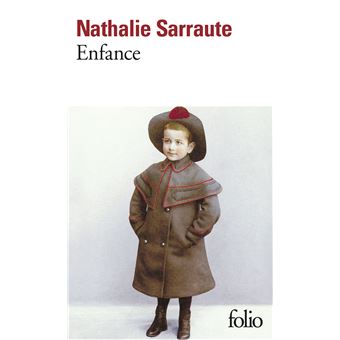 Les grandes sœurs mortes n’étaient pas rares avant les antibiotiques et la généralisation de la vaccination des enfants… Et voici qu’en surgit une troisième qui allonge de manière imprévue ce billet : Hélène, sœur de Nathalie Sarraute, morte de la scarlatine un an avant la naissance de « Natacha » en 1900, et trois ans avant le divorce de ses parents.
Les grandes sœurs mortes n’étaient pas rares avant les antibiotiques et la généralisation de la vaccination des enfants… Et voici qu’en surgit une troisième qui allonge de manière imprévue ce billet : Hélène, sœur de Nathalie Sarraute, morte de la scarlatine un an avant la naissance de « Natacha » en 1900, et trois ans avant le divorce de ses parents.
Ann Jefferson dit dans sa biographie de Sarraute publiée en 2019 : « Née après la disparition de sa sœur, elle eut toujours le sentiment que la mort rôdait autour de son enfance ». Dédoublement et déchirement marquent d’ailleurs ce livre.
Mais la chose se complique : quand le père de Nathalie Sarraute se remariera, il aura de sa seconde femme une nouvelle Hélène (en mémoire de la disparue) : la petite peste surnommée « Lili » dans Enfance. Avec sa méfiance pour les interprétations biographiques, Sarraute ne met pas du tout ce genre de détail en avant pour expliquer sa nécessité de défendre bec et ongles son territoire d’écriture singulier, mais il est probable que c’est, entre autres choses, lié à cette situation inconfortable entre deux parents, deux pays, deux Hélène.
Lien vers le billet d’octobre 2021 : https://patte-de-mouette.fr/2021/10/29/la-muette/