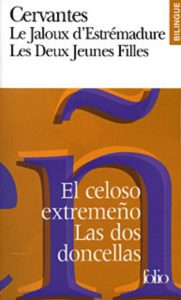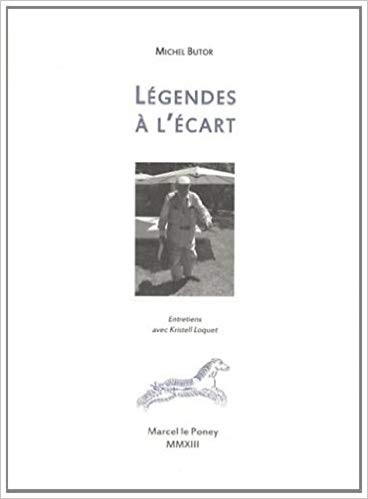Lors d’un colloque de Cerisy de 1971, à la fin de sa communication intitulée « Ce que je cherche à faire », Nathalie Sarraute affirme que le lecteur est « libre de pousser ses investigations et de laisser vagabonder son imagination dans toutes les directions ». Puis elle émet une réserve de taille :
Une seule pourtant devrait, me semble-t-il, lui être interdite. Celle qui tire le texte vers ce qu’il se refuse à être, vers ce qu’il cherche à combattre, vers ce dont au prix de grands efforts il s’est écarté (texte repris dans les Oeuvres complètes en Pléiade, p. 1706).
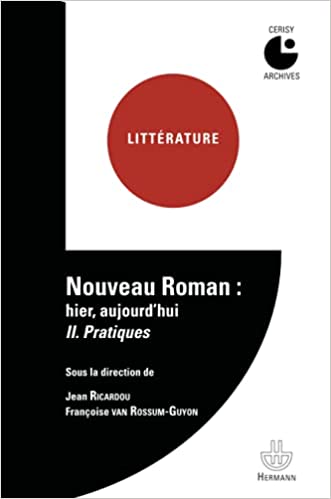 Comme le savent tous ses commentateurs, Nathalie Sarraute avait besoin que l’on soit complètement “cramponné” à son projet d’écriture. Au cours de la discussion qui suit cette intervention, Robbe-Grillet ne manque pas de lui rétorquer qu’un lecteur a tous les droits, y compris celui de comprendre le contraire de ce que veut l’auteur.
Comme le savent tous ses commentateurs, Nathalie Sarraute avait besoin que l’on soit complètement “cramponné” à son projet d’écriture. Au cours de la discussion qui suit cette intervention, Robbe-Grillet ne manque pas de lui rétorquer qu’un lecteur a tous les droits, y compris celui de comprendre le contraire de ce que veut l’auteur.
***
Je me suis trouvée récemment en communication avec Estela Puyuelo, auteure du recueil de poèmes Tous les vers à soie. Un poème intitulé “Cartographe monologuiste” met en scène un exhibitionniste qui ouvre sa gabardine mauve dans un jardin public et lance un monologue sur les arbres, les collines et les plaines, déclenchant les cris d’effroi des fleurs environnantes.
L’image d’un poète s’est imposée à moi sous les traits de cet exhibitionniste, au point que je me sens prête à en faire une allégorie à usage personnel. Au lieu de me dire : “Untel va publier ceci”, “Unetelle présente son livre à tel salon”, j’ai envie désormais de me dire : “Untel va ouvrir sa gabardine tel jour à tel salon”. Derrière cette caricature se pose, bien sûr, la délicate question de la frontière entre la source intime de l’écriture et un exhibitionnisme vulgaire.
 J’ai quand même demandé à Estela Puyuelo si cette interprétation était pour elle valide. Voici sa réponse :
J’ai quand même demandé à Estela Puyuelo si cette interprétation était pour elle valide. Voici sa réponse :
“Cartographe monologuiste” parle, en fait, de ces gens qui ne parlent que d’eux-mêmes, et beaucoup. Mais je crois que ça peut parfaitement s’adapter à la poésie. En fin de compte c’est aussi un monologue et une manière de se mettre à nu devant le monde.
Visiblement, le propos principal du texte n’était pas spécialement au départ celui que je lui prêtais, mais moins intransigeante que Nathalie Sarraute, Estela a toléré avec bonne humeur cette lecture.
J’appellerai pour finir Proust à ma rescousse :
Les beaux livres sont écrits dans une sorte de langue étrangère. Sous chaque mot chacun de nous met son sens ou du moins son image qui est souvent un contresens. Mais dans les beaux livres, tous les contresens qu’on fait sont beaux (Pléiade Contre Sainte-Beuve, p. 305).